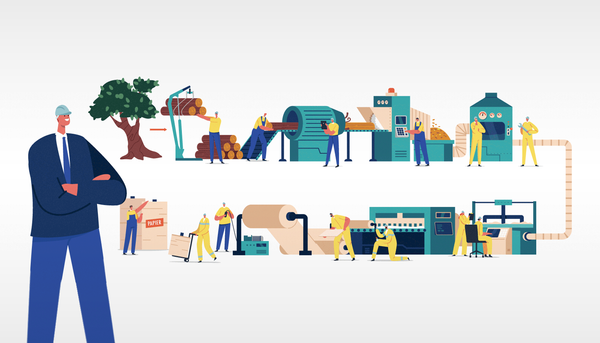La gestion de crise se met en place lors d'une précédente école d'été.
Soixante-douze heures en urgence humanitaire, dans un camp d'été entre Québec et Montréal qui se transforme en zone de crise quelque part dans le monde. Arriver, planifier comment manger, dormir, se doucher. Travailler en équipe et avec la communauté locale. Embaucher un cuisinier, un chauffeur, faire des offres d'emplois pour des infirmiers, des médecins, des logisticiens. Déterminer la façon de les payer. Rédiger une demande de subvention.
Une quarantaine d'étudiantes et d'étudiants du deuxième cycle pourront goûter au stress que vivent les travailleurs humanitaires. Pour une cinquième année, la Faculté des sciences de l'administration (FSA) propose une école d'été en simulation d'urgence humanitaire. Elle se déroulera du 8 au 20 mai, incluant quelques jours de formation à distance avec des spécialistes avant la simulation.
«Le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est non-stop. On recrée vraiment l'expérience des intervenants sur le terrain, qui doivent faire face à une situation qui se développe et qui change tout le temps, mais qui demande une réponse immédiate», indique Carlos Cano, responsable académique du programme en gestion du développement international et de l'action humanitaire à l'Université Laval.

Regroupement des effectifs lors d'une simulation antérieure

Rapidement, les travailleurs humanitaires doivent trouver où dormir et comment s'alimenter.

Réunions, planification et travail d'équipe sont au programme.
20 ans de formation
Guerre en Ukraine, séisme en Turquie et en Syrie, tempête mortelle dans l'État du Mississippi… Quand une crise humanitaire éclate, on pense d'emblée au besoin en secourisme, en aide médicale, en nourriture et marchandises. «Mais pour que ça marche, il faut que quelqu'un s'occupe des chiffres, qu'il fasse toute la partie administrative derrière», insiste Carlos Cano. C'est ici que les gestionnaires humanitaires entrent en jeu.
Depuis 20 ans, la FSA fait figure de proue en formant ces spécialistes en finance, en comptabilité et en ressources humaines pour répondre spécifiquement aux besoins humanitaires. Le programme de maîtrise, duquel découle l'école d'été, est le fruit d'une vision de Didier Cherpitel. Cet ancien secrétaire général de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à Genève, sentait le besoin de former de tels gestionnaires. Il a fondé Managers sans frontières en trouvant une oreille à l'Université Laval.
Carlos Cano cumule lui-même 7 années d'expérience en gestion humanitaire, à travers 11 interventions en Haïti, au Liban et un peu partout en Afrique. Il s'est tourné vers cette spécialité après des études en commerce et avoir réalisé qu'il ne voulait pas travailler dans le privé. Il a mis ses compétences au service d'autres desseins. S'il ressent encore une sorte d'appel quand une crise survient, il a le sentiment de collaborer indirectement en formant les futurs intervenants qui iront sur place.

Carlos Cano, responsable académique du programme en gestion du développement international et de l'action humanitaire
L'école d'été est un produit de l'Université Harvard repris par la FSA il y a quelques années. Une quarantaine de bénévoles y participent, des gens de Médecins sans frontières, de la Croix-Rouge canadienne, des Nations Unies ainsi que des ONG canadiennes et internationales «qui ont mille choses à faire, mais qui prennent le temps de donner un peu de ce qu'ils ont reçu pour aider à former la relève», salue Carlos Cano. Leur participation double le nombre de personnes lors de la simulation.
Cette école intensive est ouverte aux étudiants de deuxième cycle en gestion du développement international et de l'action humanitaire, mais aussi à ceux d'autres programmes. «Il y a des gens qui viennent d'agronomie, des sciences infirmières… C'est très multidisciplinaire.»

Des étudiantes et des étudiants de différents programmes participent à cette école intensive et multidisciplinaire.
L'anglais, langue humanitaire
Si parler l'anglais n'est pas un prérequis pour participer à l'école d'été, et qu'il est toujours possible de s'appuyer sur un coéquipier, Carlos Cano indique que la langue de Shakespeare reste le moyen universel de communiquer dans ce milieu. Même lorsque la crise éclate dans un pays francophone. «Derrière une intervention humanitaire, il y a énormément de documents à rédiger, comme la demande de fonds, qui ressemble beaucoup à un mémoire de maîtrise et qui est écrit en anglais», donne comme exemple l'ancien gestionnaire humanitaire, qui parle lui-même trois langues.
Une attention pour la santé mentale
Quand il était sur le terrain, il y a une dizaine d'années, le soutien à la santé mentale des travailleurs humanitaires n'était pas très disponible. «C'était dur, on encaissait et on passait à autre chose», décrit-il. Les temps ont changé et les organisations comptent désormais sur des psychologues et des travailleurs sociaux pour accompagner les équipes.
Un spécialiste sera d'ailleurs sur place pendant les 72 heures de simulation. «Je peux vous dire que cette personne ne chôme pas!», lance le chargé d'enseignement, en se basant sur les années précédentes. Il mentionne que la première année de pandémie, quand la simulation a été faite à distance, chacun chez soi, ils avaient laissé tomber cet aspect, ce qui s'est avéré être une «très mauvaise décision». Ce précieux appui est de retour depuis.
L'endroit où les étudiants débarqueront au Québec est gardé secret, mais ils auront à travailler sur une «situation fictive, dans un contexte réel», comme s'ils étaient dans une région du Congo, par exemple. Ils devront consulter Internet pour connaître la population, les problèmes de sécurité, les langues parlées. «On n'est pas des superhéros; on ne va pas sauver le monde tout seul, il faut travailler en équipe et avec la communauté», insiste Carlos Cano, sans minimiser l'urgence d'agir.
Un test révélateur
Quelles sont les aptitudes requises pour participer à ce genre de mission, selon lui? Bien se connaître et pouvoir faire face au stress. L'objectif de cette école d'été est aussi de servir de test pour les étudiants. «Ça arrive chaque année, des gens disent: "Non, finalement, ce n'est pas pour moi". Tant mieux s'ils s'en rendent compte en étant à côté de Québec et non pas quelque part où ça pourrait être dangereux!»
Pour d'autres, c'est la révélation. Carlos Cano pense notamment à Kristine Ford, qui a fait l'école d'été il y a quelques années et est finissante à la maîtrise en gestion du développement international. Elle est aujourd'hui en Ukraine avec Médecins sans frontières. «En 20 ans d'existence du programme, avec 600 diplômés, ces gens-là sont partout aujourd'hui.»
La période d'inscription pour l'école d'été est commencée et 40 places sont offertes.
Cette année, la simulation est dirigée par Gautham Krishnaraj et organisée par Partenaires humanitaires internationaux, une équipe de professionnels combinant des décennies d'expérience dans la formation basée sur la simulation, la recherche et la réponse humanitaire mondiale.