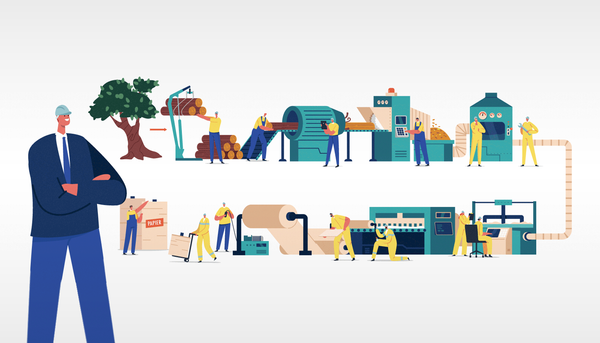Lidia Côté, de l’Université Laval, a obtenu ex æquo le prix Meilleur plaideur ou meilleure plaideuse, selon les points obtenus lors de la joute préliminaire.
Quinze minutes. Voilà le temps dont disposait Lidia Côté pour briller à la mi-février. L'étudiante en troisième année du baccalauréat en droit à l'Université Laval participait au 45e Concours de plaidoirie Pierre-Basile Mignault, qui oppose les six facultés canadiennes de droit civil. Parmi les 24 candidats à plaider, elle a remporté la première place, ex æquo avec une consœur de l'Université du Québec à Montréal.
«C'est vraiment un travail d'équipe!», lance la jeune femme, aussi coiffée du titre du meilleur tandem de la partie intimée avec Fabrice Turgeon, lors des joutes préliminaires. Camille Charlebois et Frédéric Magnan, aussi de la Faculté de droit de l'Université Laval, représentaient la partie appelante dans cette épreuve fondée sur un jugement fictif.
«Cette année, le sujet était le droit des biens en lien avec les impenses [les dépenses faites par le propriétaire ou par un tiers en vue de la conservation ou de l'amélioration d'un bien, NDLR]. Donc dans le cas qui nous intéresse, qu'est-ce qui arrive quand une personne, sans faire exprès, s'est bâtie sur le terrain du voisin? Si vous avez construit chez le voisin, la construction devient à lui à cause des règles de l'accession. Sauf que tout dépend de votre bonne foi, de la valeur de la construction. Il peut y avoir compensation ou pas», résume Lidia Côté.
Cinq mois de préparation
Les quatre étudiants sélectionnés dans chaque université (cinq universités québécoises ainsi que l'Université d'Ottawa), ont reçu le jugement au début de l'automne dernier. S'en est suivi un travail de recherche et la rédaction d'un mémoire en équipe de deux. Puis dès janvier, la préparation a commencé. La lauréate salue l’aide de ses entraîneurs à la Faculté de droit, le professeur Mario Naccarato et la chargée d’enseignement Isabelle Hudon. Sur quatre ans, le duo a formé des gagnants du prix Meilleur plaideur ou meilleure plaideuse à trois reprises.
Les participants au concours ont eu accès à un réseau d'avocats et de juges pour les pratiquer, leur poser des questions, leur demander des compléments d'information. «C'est extraordinaire, parce que ça nous faire vivre le stress, ça nous fait voir comment on réagit, ça nous éveille sur des questions différentes, ça nous permet d'être mieux outillés», glisse Lidia Côté.
Même si elle faisait équipe avec Fabrice Turgeon, elle indique que les quatre étudiants de l'Université ont vraiment travaillé ensemble d'arrache-pied à s'improviser juge à tour de rôle. «On les a observés, ça permettait ensuite d'aller dans les zones où ils étaient moins à l'aise», dit-elle en soulignant que le but commun était de s'améliorer.
C'est dans ce climat d'entraide que s'est déroulée la compétition et les plaidoiries devant Suzanne Côté, juge à la Cour suprême du Canada, Manon Savard, juge en chef de la Cour d'appel du Québec, et France Dulude, juge retraitée de la Cour supérieure du Québec. «Camille et Frédéric passaient avant; j'étais là pour les motiver, leur rappeler des astuces. Une fois à mon tour, ils m'ont même mis ma toge! Quand je plaidais, je les savais derrière moi.»
Si bien qu'au final, en effectuant le total des points pour les quatre plaidoiries et les deux mémoires écrits, l'Université Laval est arrivée seconde au concours.

Camille Charlebois, Lidia Côté, Frédéric Magnan et Fabrice Turgeon représentaient l'Université Laval au concours cette année.
Confiance, aplomb, humilité
Comment obtient-on le prix de la meilleure plaideuse? Quelles sont les qualités et les aptitudes requises? «Ça prend une bonne confiance en soi, répond l'étudiante, mais surtout une bonne confiance en notre préparation. Il faut avoir pris le temps de bien maîtriser le sujet, et même d'avoir lu sur les choses qui pourraient nous nuire, pour être prêt à réfuter ce qui pourrait surgir lors de la plaidoirie.» Un autre atout est de connaître les gens que l'on défend, même s'ils étaient fictifs dans ce cas-ci.
Lidia Côté parle de l'importance du contact visuel avec les gens à qui l'on s'adresse. Il faut décoder le non verbal, dit-elle. «Un juge qui fronce les sourcils, ça peut indiquer qu'il a une question. Il vaut peut-être mieux s'arrêter pour éviter qu'il n'écoute plus la suite pour ne pas oublier. Ou de le situer dans nos documents pour qu'il puisse suivre et faire des liens», illustre l'étudiante.
Elle ajoute qu'il faut prendre le temps de bien répondre aux questions et de le faire sur-le-champ. «Quand une question négative arrive, il ne faut pas hésiter à rebondir sur un point fort de notre argumentation. Ça prend une belle gymnastique intellectuelle. Il faut oser, parler avec aplomb, confiance, mais rester humble.»
Enfin, pour que toute l'attention soit concentrée sur les paroles, le plaideur doit contrôler sa gestuelle, dit celle qui espère terminer son baccalauréat en juin après sa session d'été et entrer à l'École du Barreau à l'automne.

Lidia Côté a été doublement couronnée, en remportant aussi le titre du meilleur tandem de la partie intimée avec Fabrice Turgeon, lors des joutes préliminaires.
Son désir d'être avocate et de plaider lui vient du film A Time to Kill, où un avocat défend un ouvrier agricole noir du Mississippi qui a vengé sa fille kidnappée, violée et laissée pour morte par deux délinquants blancs. «Quand j'ai entendu son incroyable plaidoirie, je me suis dit: quel bel effet et quel impact ça peut avoir sur la décision finale.»
Plaider n'est pas donné à tous, convient toutefois Lidia Côté. «La grande majorité des avocats ne plaident pas. Mais le droit est tellement riche et varié, même quelqu'un de gêné trouvera sa place. Derrière un avocat qui plaide, il y en a plein d'autres, que ce soit en recherche, pour donner des conseils aux entreprises privées, aux hôpitaux, à l'international… Certains travaillent à aider les juges.»
Québec et la particularité du droit civil
La future plaideuse aimerait pour sa part travailler en droit civil, plus précisément en droit du litige. Le concours auquel elle a participé est une belle occasion, selon elle, de susciter l'intérêt des étudiants au droit civil, un héritage du régime français. «Pierre-Basile Mignault a été juge à la Cour suprême du Canada et il a toujours défendu qu'au Québec, on a cette particularité-là, qu'ils n'ont pas au Canada anglais, et à quel point c'est important de la préserver. Tout ce qui est contrat, obligation, succession, droit des biens, droit des sûretés, hypothèques, c'est dans le Code civil du Québec, ce qui est différent des autres provinces.»
L'étudiante explique que c'est la raison pour laquelle il y a toujours trois juges à la Cour suprême du Canada qui ont fait du droit civil pour pouvoir entendre les causes du Québec. En contrepartie, tout ce qui est droit criminel et pénal, les droits des faillites, est régi par le fédéral et la common law.
Le concours, poursuit Lidia Côté, lui a aussi permis de parfaire certaines connaissances. «Dans notre mise en situation, Camille et Frédéric représentaient le pauvre monsieur qui s'était construit sans faire exprès chez le voisin, et nous, on représentait une fiducie environnementale. J'ai trouvé vraiment intéressant d'en apprendre davantage sur les fiducies, qui sont moins connues au Québec comparativement aux trusts dans le reste du Canada. C'est quelque chose qui est effleuré dans notre parcours scolaire. Et le fait que ce soit une fiducie environnementale, c'est vraiment collé à l'air du temps. C'était brillant tout ça!», salue la lauréate, emballée par son expérience.