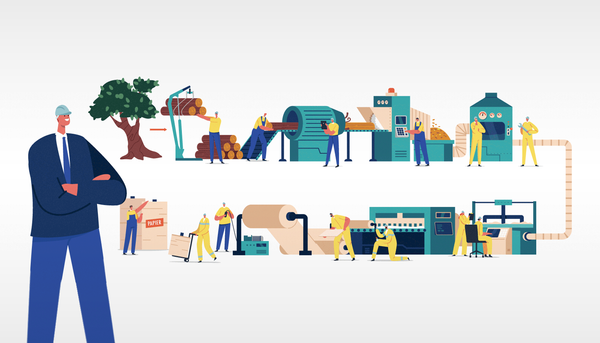Le rapport intitulé Regard sur l’enseignement et l’apprentissage, après 20 mois de pandémie souligne le haut niveau d’engagement, de résilience, de détermination et de créativité dont ont fait preuve le personnel enseignant, les étudiants et le personnel administratif et de soutien de l’Université.
— Getty Images
La pandémie de COVID-19 a créé, à l’échelle planétaire, l’une des plus grandes perturbations des systèmes d’éducation supérieure de l’histoire.
À l’Université Laval, un immense travail collectif a été nécessaire depuis deux ans pour assurer la continuité des activités d’enseignement et d’apprentissage. Durant cette période, de nouvelles pratiques pédagogiques ont émergé, alors que d’autres ont été profondément transformées. Il existe maintenant une volonté de renforcement de la capacité à s’appuyer sur une plus grande diversité d’outils technologiques et de formules d’enseignement. En ce qui concerne les préférences exprimées par les étudiantes et étudiants au regard des différentes formules d’enseignement, elles se révèlent hautement variables, et ce, selon l’âge, le cycle d’études, le régime d’études, le domaine disciplinaire et le type de programme d’études. L’automne 2022 devrait donc reposer sur une diversité de formules. De plus, les étudiantes et étudiants démontrent un intérêt marqué pour retrouver la vie sur le campus, pour un meilleur équilibre entre enseignement en présentiel et enseignement à distance et pour une ouverture à l’innovation pédagogique.
Ces observations sont tirées du rapport intitulé Regard sur l’enseignement et l’apprentissage, après 20 mois de pandémie, réalisé par le Groupe de travail sur la transition postpandémique des pratiques d’enseignement et d’apprentissage. Le mardi 1er mars, les membres du Conseil universitaire réunis en séance ordinaire ont reçu ce document déposé conjointement par le vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes, Robert Beauregard, et le directeur du Service de soutien à l’enseignement, Nicolas Gagnon.
«Le Groupe de travail a relevé un défi: celui de positionner le rapport comme une base à partir de laquelle réfléchir à notre avenir postpandémique, explique Nicolas Gagnon. Nous sommes sur la ligne de départ d’une réflexion qui va se poursuivre sur plusieurs années.»
Le Groupe de travail a été formé en septembre 2021 afin de poser un regard sur les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les pratiques d’enseignement et d’apprentissage. Robert Beauregard en a assuré la présidence. Ce groupe était composé de 11 personnes, soit deux vice-recteurs dont Robert Beauregard, cinq doyens, deux vice-recteurs adjoints, le directeur Nicolas Gagnon, ainsi que la directrice du Bureau de la qualité des programmes.
«Le but visé, poursuit-il, était exploratoire et consistait d’une part à déterminer les enjeux et questions devant faire l’objet de réflexions futures et, d’autre part, à établir des repères pour l’action dans le cadre de la transition postpandémique.»
Une consultation et un sondage
Une vaste consultation a été mise sur pied afin de prendre une photographie permettant de connaître, à un moment où la pandémie semblait s’approcher de son terme, la perspective de plus d’une centaine d’enseignants, de membres du personnel de soutien pédagogique et d’administrateurs. Ces personnes ont pris part à des groupes de discussion en décembre et janvier derniers. De plus, 19 898 étudiantes et étudiants ont participé à un sondage réalisé en décembre 2021, ce qui représentait 41,3 % de la population étudiante totale inscrite à l’automne 2021.
«Nous sommes très heureux de la participation non seulement des étudiants, mais aussi des enseignants, des membres du personnel de soutien pédagogique et des administrateurs, indique le directeur. Les données recueillies fournissent des informations riches et issues du terrain. Mais il s’avère primordial d’interpréter, d’équilibrer et de contextualiser ces informations avec prudence.»
Les données, sous forme de vues locales et anonymisées, viennent d’être partagées aux équipes de direction facultaires et aux associations étudiantes. Le rapport, quant à lui, sera rendu disponible à différents professeurs, chercheurs et doyens pour poursuivre l’analyse et la réflexion.
«La pandémie aura inévitablement des effets à long terme sur les systèmes d’éducation supérieure, mais nous ne saurons pas avant longtemps sous quelle forme et dans quelle mesure les répercussions durables se manifesteront, soutient Nicolas Gagnon. D’autres consultations, sur une période longitudinale, devront être réalisées. Tous les intervenants le demandent. Il est déjà prévu de refaire l’exercice à l’automne 2022, en 2023 et probablement en 2024. Ce printemps, les unités d’enseignement et les équipes programmes analyseront les données recueillies et leur donneront un sens “localement”. Il est important de se donner du temps.»
Le témoignage d’un doyen
Le rapport souligne le fait que, depuis deux ans, le contexte pandémique à l’Université a amené le corps professoral, le personnel enseignant, les étudiantes et étudiants ainsi que le personnel administratif et de soutien à faire preuve d’un haut niveau d’engagement, de résilience, de détermination et de créativité afin d’assurer la continuité des activités. Ce fut notamment le cas à la Faculté des sciences de l’éducation.
«L’effort a été exigeant pour l’ensemble du personnel et particulièrement pour les enseignants, en fonction de l’adaptation des contenus de cours aux modalités de l’enseignement en ligne», indique Fernand Gervais, l’un des doyens membres du Groupe de travail sur la transition postpandémique des pratiques d’enseignement et d’apprentissage.
«La Faculté des sciences de l’éducation a pu compter sur les professeurs ayant une expertise en technologie éducative, poursuit-il. Ils ont bien épaulé ceux de leurs collègues qui ont dû se familiariser avec de nouveaux outils. Ce fut une adaptation inévitablement “forcée” pour plusieurs dans une transition vers l’enseignement à distance. À ce chapitre, il faut souligner l’excellente collaboration de notre service de soutien à l’enseignement et de notre centre de services et de ressources en technopédagogie.»
Selon le doyen, il faudra accorder une attention spéciale aux diplômées et diplômés du cégep ayant fait leur entrée à l’Université depuis 2020. «Nous avons réalisé, explique Fernand Gervais, qu’en début de formation en particulier, les étudiantes et étudiants ont besoin d’être sur le campus. Un enseignement à distance est plus ou moins souhaitable pour leur intégration. À l’inverse, les étudiants plus âgés démontrent plus d’intérêt pour l’enseignement à distance. Cela dit, il semble que la perspective des étudiantes et étudiants varie selon leur faculté d’appartenance.»