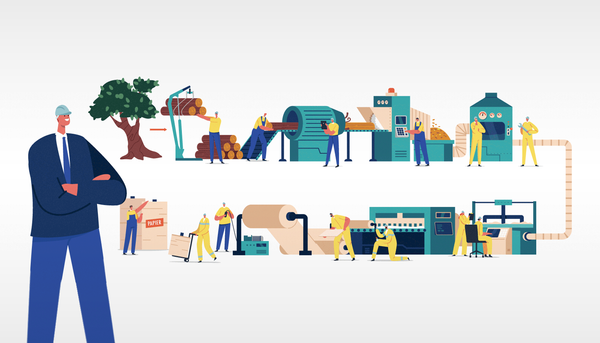En 2017, la finissante au baccalauréat en sciences infirmières Anne-Charlotte Lebel a réalisé un stage international et interculturel de deux mois au Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest. Elle a notamment participé aux suivis de femmes enceintes, à des accouchements et aux suivis postnataux dans un centre de santé et de promotion sociale de la ville de Yako.
— Kevin Dickie
L’éducation internationale permet aux génération actuelles et futures de Canadiens d’acquérir une perspective mondiale, ce qui les aide à devenir des citoyens du monde pouvant contribuer à la «diplomatie du savoir».
Ce commentaire du Comité consultatif sur la Stratégie du Canada en matière d’éducation internationale figure comme citation introductive à un avis de plus de 160 pages de la Commission des études intitulé L’Université Laval au diapason du monde: l’internationalisation de la formation. Le mardi 2 février, la présidente de la Commission, Marie Audette, a fait la présentation de ce document aux membres du Conseil universitaire réunis en mode virtuel.
«Nous avons travaillé trois ans sur ce projet, compte tenu du mandat très large que nous avions reçu de la rectrice, explique-t-elle. Ce mandat sur l’internationalisation se situe dans le contexte de mondialisation où les besoins de formation évoluent et se diversifient rapidement. Nous avons épluché la littérature scientifique. Nous avons fait le tour de tout ce qui se fait à l’Université en la matière. Nous avons dressé un portrait de ce qui s’est réalisé depuis 1993. Cela nous a permis de voir d’où l’on vient. Bien des gens ont tracé des pistes avant nous.»
Selon la présidente de la Commission, l’Université a fait preuve de vision en adoptant, dès 1996, une politique de l’internationalisation de la formation. En 1999, le Bureau international voyait le jour. En 2006, la Commission des affaires étudiantes publiait un avis sur l’accueil, l’encadrement et l’intégration des étudiants étrangers à l’Université. L’année suivante, la Commission des études publiait le document S’éduquer au monde chez soi: la formation locale à l’international.
«La politique de 1996, souligne-t-elle, a toujours cours aujourd’hui. Limitée au début au premier cycle, elle s’est élargie aux trois cycles d’études. Et elle touche plus que la formation comme telle. On parle de valeurs, des activités de recherche, c’est très englobant. De nos jours, on parle beaucoup de mobilité, de recrutement. Mais la politique institutionnelle va au-delà de ça. Elle repose sur le développement de compétences interculturelles. La littérature sur le sujet précise que ces compétences passent par la conscience culturelle de l’autre, la capacité d’écouter, d’observer et de faire des liens afin de minimiser l’ethnocentrisme.»
À l’Université, 13% de l’effectif étudiant provient de l’étranger
L’internationalité de l’Université Laval comprend un important volet consacré à la mobilité des étudiants. Celle-ci peut être entrante ou sortante, diplômante ou non diplômante. Elle concerne aussi les chercheurs postdoctoraux.
Le recrutement se fait dans la francophonie d’Europe et d’Afrique, et dans les pays francophiles. À l’Université Laval, les effectifs internationaux semblent avoir atteint une certaine stabilité depuis 2014-2015, soit autour de 13 %. Le recrutement international est en croissance aux 2e et 3e cycles depuis 2008. Soixante-deux pour cent des étudiants internationaux ont le français comme langue maternelle et 78% comme langue d’usage. La France est le principal pays partenaire. Les programmes les plus populaires en matière de recrutement sont, notamment, les programmes en administration des affaires et de nombreux programmes de formation à la recherche de 2e et 3e cycles.
Rappelons, par ailleurs, que bon an mal an environ 15% des étudiants québécois inscrits à l’Université effectuent une partie de leurs études à l’étranger.
L’expérience internationale consiste également en l’internationalisation chez soi.
«Ce dernier concept connaît un développement fulgurant, renforcé aujourd’hui par la pandémie, indique Marie Audette. Les universités l’ont priorisé, d’abord en Europe. Ce concept est né sur ce continent à la fin des années 1990 en réaction aux résultats décevants des programmes de mobilité étudiante tels qu’Érasmus. Après 10 ans, seulement 10% des étudiants européens avaient réalisé une partie de leur formation à l’international.»
Selon elle, l’internationalisation chez soi permet d’aller au-delà du simple bénéfice économique ou concurrentiel. Elle offre aussi aux étudiants l’occasion de développer des compétences interculturelles transversales liées à leur développement personnel et professionnel. Elle met également en place les conditions favorables à un engagement social et professionnel inclusif.
L’internationalisation chez soi peut prendre plusieurs formes. L’étude d’une langue étrangère en est une. L’engagement actif, en classe, des étudiants internationaux, des étudiants de retour de mobilité et des étudiants issus de la diversité culturelle en est une autre. Les clubs de langues et l’intégration, à dessein, de dimensions internationales et interculturelles aux cheminements officiels et officieux pour tous les étudiants en sont d’autres exemples.
Une cinquantaine de recommandations
L’avis contient une cinquantaine de recommandations. Une quinzaine d’entre elles portent sur les compétences langagières. Il est notamment recommandé d’accorder une meilleure visibilité à l’année d’immersion en français dans toutes les communications visant le recrutement d’étudiants au premier cycle. Il est également recommandé de faire la promotion de l’École de langues de l’Université Laval comme milieu de vie et d’intégration. Une autre recommandation vise la création d’outils permettant de reconnaître officiellement la démarche de francisation d’un étudiant lorsque cette démarche ne cadre pas avec un microprogramme ou un certificat.
«Le développement de compétences langagières est aussi important pour les étudiants francophones que pour les étudiants non francophones, soutient Marie Audette. L’idée consiste à parfaire son diplôme international sur le plan linguistique. De nombreuses langues sont enseignées à l’École de langues, dont l’anglais, la lingua franca dans la communication internationale. La maîtrise d’une deuxième langue est d’ailleurs un des objectifs de formation de tout programme de baccalauréat selon notre Règlement des études.»
En ce qui concerne les compétences interculturelles, il est recommandé que l’Université mette en place un exercice de réflexion sur la direction qu’elle désire suivre en matière de développement des compétences interculturelles aux trois cycles, et que l’ensemble de la communauté universitaire soit conviée à cet exercice. Une autre recommandation demande qu’un comité intersectoriel détermine les cours et les programmes qui permettent de développer les compétences interculturelles et internationales aux trois cycles.
«En ce domaine, dit-elle, il s’agit de s’assurer que le diplôme permet d’aborder le monde avec ouverture et curiosité.»
Consulter les documents et avis officiels de l’Université Laval

À l’Université Laval, le recrutement international se fait dans la francophonie d’Europe et d’Afrique, et dans les pays francophiles. Il est en croissance aux 2e et 3e cycles depuis 2008. Soixante-deux pour cent des étudiants internationaux ont le français comme langue maternelle et 78% comme langue d’usage. La France est le principal pays partenaire.
— Élias Djemil