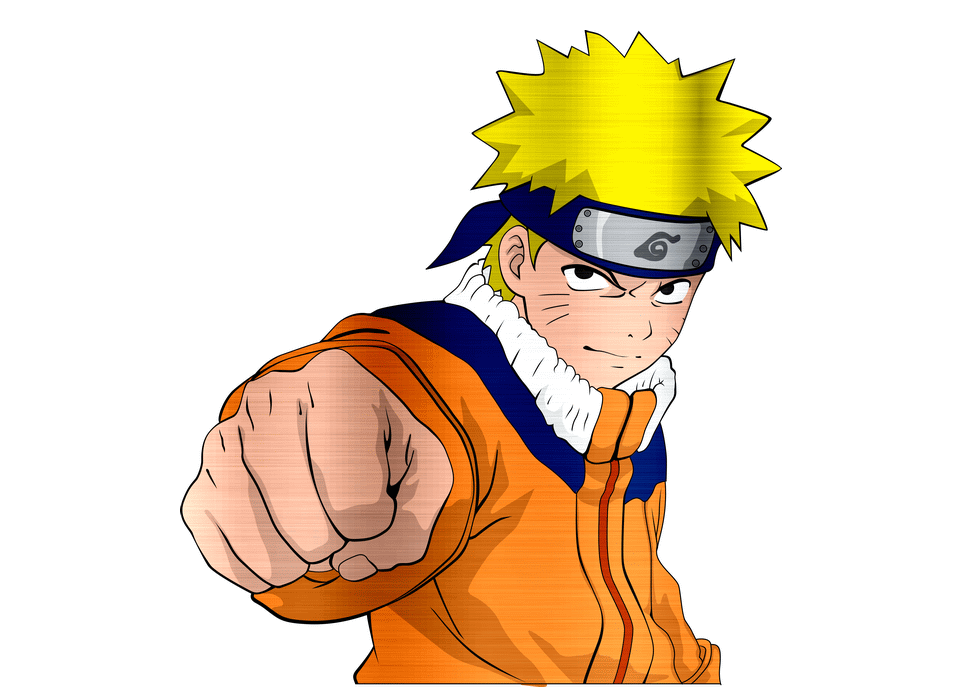
Spécialiste de la culture japonaise, la doctorante en sociologie Valérie Harvey a épluché les mangas en version originale. À partir des textes et des images, elle a analysé divers éléments narratifs qui forgent le récit. Son constat, publié dans le dernier tome de la collection L'univers social des arts martiaux aux Presses de l'Université Laval, est que cette œuvre est représentative des valeurs japonaises.
Naruto, précisons-le, est un shônen manga, c'est-à-dire une bande dessinée pour adolescents. L'histoire est celle de Naruto Uzumaki, un orphelin qui s'entraîne pour devenir le plus grand ninja et le chef de son village. À l'intérieur de lui se trouve un démon destructeur, le renard à neuf queues, dont la force lui brûle littéralement la peau. Peu à peu, il apprendra à se servir de ce pouvoir pour devenir aussi puissant que le soleil.
Pour Valérie Harvey, le parcours de ce protagoniste incarne bien la philosophie des Japonais en ce qui a trait au succès. «La force de Naruto lui vient de tous ceux qui ont cru en lui et qui lui ont permis d'avancer et d'atteindre un niveau supérieur. Au Japon, la réussite est avant tout collective. Le succès n'est pas dû au talent d'une seule personne comme c'est le cas dans le monde occidental, où l'on encense les gens qui réussissent par eux-mêmes.»
À l'instar de Naruto, le récit comprend son lot de métaphores et de symboles. Le pays du Feu, où vit le personnage, représente le Japon, situé sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone en proie aux volcans et aux tremblements de terre. Créature à la fois bénéfique et maléfique, le renard à neuf queues incarne la résilience de la population face aux désastres de la nature. Le pays de la Foudre, avec son armée puissante, est symbolique de la manière dont les Japonais perçoivent les États-Unis. Ses habitants sont les seuls à avoir des physionomies différentes et diverses couleurs de peaux. Parmi eux, Samui est sans doute l'archétype de la pin-up hollywoodienne, avec ses cheveux blond platine, sa taille fine et sa poitrine surdimensionnée.
Contrairement à d'autres mangas, les personnages féminins sont nombreux dans Naruto. Très souvent, ils occupent des fonctions de leaders ou ont de super pouvoirs. «Avec Naruto, on évite le syndrome de la Schtroumpfette, soit le fait de mettre en scène un ou deux personnages féminins à des fins décoratives. Cela ne veut pas dire que l'on est exempt de problèmes. La plupart des femmes puissantes dans Naruto sont célibataires. Soit elles souffrent parce qu'elles sont seules, soit elles sont amoureuses de quelqu'un qui ne les aime pas ou qui les aime mal. Pour fonder une famille, elles doivent mettre un terme à leur vie de guerrière. À l'inverse, les exemples d'hommes puissants qui ont une famille sont nombreux.»
Une fois de plus, ce choix narratif n'est pas anodin. Dans le cadre de sa maîtrise en sociologie, qui portait sur la maternité au Japon, Valérie Harvey a découvert que les femmes sont placées devant un choix déchirant: travailler ou avoir des enfants. Les rôles de genre et la pression sociale exigent des Japonaises qu'elles restent à la maison pour s'occuper de leur bébé. «Plusieurs femmes qui ont des emplois importants se retirent du marché du travail une fois qu'elles deviennent mères. Dans d'autres cas, elles font le choix de ne pas avoir d'enfant afin de poursuivre leur carrière. On se retrouve donc dans la même situation que celle des femmes fortes dans Naruto.»
Bien qu'il présente un univers on ne peut plus japonais, Naruto véhicule des messages qui font écho aux préoccupations des jeunes à travers le monde, selon la doctorante. Entre autres, une grande importance est accordée à l'alliance avec les plus petits et à la paix entre les peuples. «Le monde réel de ce début du 21e siècle peint un portrait tendu des relations entre les dirigeants des différents pays, entre les religions aussi. […] Les discours du manga Naruto qui portent l'espoir que la paix soit possible, par une plus grande harmonie entre les peuples, ont sans doute besoin d'être entendus dans le monde réel, bien au-delà des limites de la fiction d'où il émerge», conclut l'auteure dans son étude.


























