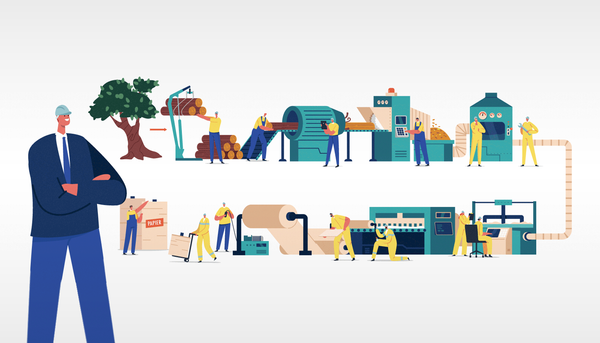Tous les membres du GAUL présents à Ciel d'octobre 2015.
«Plutôt qu'une compétition, la rencontre est davantage un événement d'essais de prototypes», indique Vincent Rocheleau, inscrit au baccalauréat en génie électrique et membre du Groupe aérospatial de l'Université Laval (GAUL). L'Université était représentée par 25 étudiants membres du Groupe. Les autres établissements universitaires présents étaient l'École de technologie supérieure de Montréal et l'École polytechnique de Montréal.
Cette journée-là, deux petites fusées préfabriquées, achetées sur Internet puis assemblées, ont été lancées avec succès par de nouveaux membres du GAUL. Deux étudiants expérimentés ont, quant à eux, lancé trois autres fusées dites de haute puissance qu'ils avaient conçues et construites.
L'un d'eux est Olivier Lacroix. Inscrit au baccalauréat en génie mécanique, celui-ci a lancé avec succès une fusée haute de 1,8 mètre et pesant 2,5 kilos sans le moteur. Fait de fibre de carbone, de fibre de verre et de plastique, l'engin a atteint une vitesse maximale de 386 mètres à la seconde. Son altitude maximale a été de 505 mètres.
Ce vol a permis à l'étudiant d'obtenir sa certification électronique. «Le lancement n'avait pas pour but une haute altitude ou une vitesse importante, explique Olivier Lacroix. Le but était simplement de faire un vol d'essai à basse altitude pour faciliter la récupération des sections de la fusée. Celle-ci est conçue pour des vols supersoniques et pour des altitudes beaucoup plus importantes, jusqu'à 3 600 mètres.»
Au bout de quelques secondes de vol, après avoir brûlé tout son carburant, la fusée d'Olivier Lacroix, rendue à son apogée, a amorcé sa descente. Soudain, de la poudre noire a explosé, séparant la partie centrale et le propulseur. Ces sections sont toutefois demeurées reliées par une corde. Entre elles se trouve un petit parachute. Celui-ci se déploie aussitôt. Parce qu'il est petit, la fusée perd de l'altitude assez rapidement. En retour, l'engin ne s'éloigne pas trop de la zone de lancement. Près du sol, une nouvelle séparation se produit, cette fois entre la partie supérieure et le nez de la fusée. Ici aussi, les sections demeurent reliées par une corde. La fusée se présente donc comme un ensemble de sections toutes reliées entre elles. Cette fois, un parachute principal se déploie entre le nez et la partie supérieure. Il permettra un atterrissage en douceur de chacune des sections de la fusée.
«Pouvoir compter parmi nos membres sur des fuséologues expérimentés comme Olivier Lacroix ou Frédéric Jobin, qui a lancé deux fusées ce jour-là, donne la possibilité au GAUL de fabriquer et de lancer des fusées haute puissance», souligne Vincent Rocheleau.
Chaque année, le GAUL fabrique une fusée pouvant atteindre un peu plus de trois kilomètres d'altitude avec une charge utile de 4,5 kilos. Tout cela en vue d'une participation au concours Intercollegiate Rocket Engineering Competition. Cette compétition interuniversitaire oppose plusieurs universités américaines et canadiennes. En juin 2015, la fusée du GAUL, haute de 2,1 mètres, avait atteint une altitude de 3 505 mètres et une vitesse maximale de 0,8 Mach.
Fabriquer une fusée haute puissance représente tout un exploit, au dire de Maxim Bergeron, le conseiller technique qui chapeaute le Groupe. «Les étudiants, explique-t-il, doivent, pour l'essentiel, utiliser leurs aptitudes de recherche. Le programme de génie donne les bases. C'est un peu la même chose pour tous les projets étudiants. Il faut procéder à des recherches supplémentaires, poser des questions dans l'industrie, expérimenter… surtout s'ils fabriquent eux-mêmes leurs propres sous-systèmes de fusée. Cela augmente le niveau de difficulté.»
Pour plus d'information sur les activités du GAUL.
Le lecteur peut aussi visionner la vidéo consacrée à la participation du Groupe à la compétition en Utah, en juin 2015.