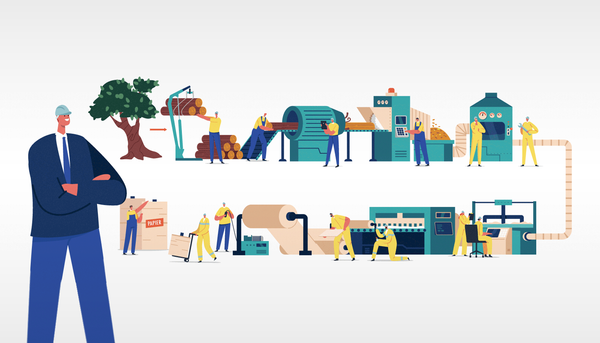Une mère crécerelle couvant ses oeufs en juin 2014 dans un des nichoirs installés par les étudiants de l'Université.
— Vanessa Audet-Giroux
«Notre association a installé environ 70 nichoirs en nature il y a quelques années dans la région de Québec pour aider la crécerelle en matière d'habitat et pour faire le suivi de la reproduction de cet oiseau», explique l'étudiant Jérémie Fuller, inscrit à la maîtrise en biologie et vice-président de la section. Chaque année, à la fin de l'hiver, la section envoie ses membres effectuer une inspection de l'état des nichoirs. «La tournée est maintenant terminée, poursuit-il. Elle consiste à déglacer les nichoirs, à nettoyer résidus et débris, et à rajouter des copeaux de bois à l'intérieur. Les nichoirs seront prêts à recevoir un couple de crécerelles chacun lorsque le temps de la reproduction battra son plein.»
Les nichoirs destinés au plus petit faucon d'Amérique du Nord se trouvent notamment à l'île d'Orléans, à Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la MRC de Lotbinière et dans la MRC de Portneuf. Ils sont installés dans des endroits tranquilles proches de milieux ouverts, à quelque cinq mètres du sol, dans de grands arbres isolés ou bien au mur de bâtiments telle une grange.
De la taille d'un geai bleu, la crécerelle d'Amérique peut être observée de mai à décembre. Ce petit rapace évolue dans les prairies ou les champs agricoles. Son vol est agile et rapide. Il est souvent perché sur un fil électrique ou sur un poteau. Il se nourrit principalement d'insectes et de petits rongeurs. La femelle pond de quatre à six oeufs. La croissance des jeunes est très rapide.
Le projet Crécerelle se poursuivra au mois de juin. Les étudiants feront une nouvelle tournée du réseau de nichoirs. Ils vérifieront lesquels sont occupés par un couple de crécerelles et s'il y a un nid et des oeufs. En juillet, des étudiants, accompagnés de la technicienne en travaux d'enseignement et de recherche au Département de biologie Marie-Claude Martin, procéderont à l'opération de baguage. Celle-ci est habilitée par le Bureau de baguage du Service canadien de la faune à poser une bague de métal sur la patte de jeunes crécerelles.
«Nous allons chercher les oisillons dans le nichoir, indique-t-elle. Ils sont ensuite pesés individuellement et on mesure la longueur de l'aile. Nous déterminons l'âge et le sexe à l'aide du plumage et, en dernier lieu, je pose une bague sur la patte de l'oiseau.»
Ces bagues sont de taille réglementaire pour l'espèce et sont fournies par le Bureau de baguage. Chaque bague a un numéro unique et porte le numéro de téléphone sans frais du Bureau.
«Si quelqu'un recapture l'oiseau ou retrouve l'individu mort, souligne Marie-Claude Martin, il est possible de rapporter l'information au Bureau de baguage et ainsi de connaître l'histoire de cet oiseau, notamment sa longévité, la distance parcourue pendant la migration, le site d'hivernage et la cause du décès.»
De 2011 à 2014, 20 jeunes crécerelles ont ainsi été baguées. La moitié l'a été l'an dernier seulement, et ce, à partir de deux nichoirs situés à Saint-Gilles et à Saint-Apollinaire, sur la rive sud du fleuve. «Je peux, dit-elle, affirmer sans grand risque de me tromper que le nichoir de Saint-Gilles a été occupé par le même couple reproducteur en 2011, 2012 et 2014. Un couple fidèle qui revient chaque année. Et encore en 2015, espérons-le.»
Il arrive que les parents, sortis chasser, poussent des cris en apercevant une présence humaine près du nichoir. C'est arrivé à une occasion en 2014, se rappelle Marie-Claude Martin. «Les jeunes ont alors répondu à l'appel de leurs parents en criant à quelques reprises pendant que nous étions dans le processus de baguage. Mais la période de baguage dure peu de temps. Tous les oisillons sont retournés au confort de leur nichoir à la suite des manipulations.»
Le projet Crécerelle constitue la principale activité de conservation de la section UL de la Wildlife Society. Pour plus d'information sur ce projet et sur les autres activités de la section: wildlife.ulaval@gmail.com