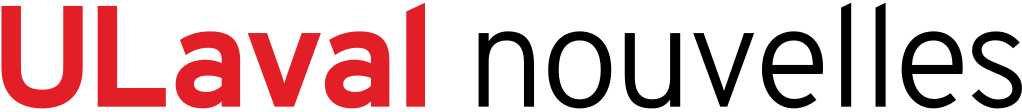Jean-Claude Bernheim de la Faculté des sciences sociales
De quelle façon ces deux décès reflètent-ils la réalité des conditions de détention au Canada ?
C’est très représentatif de ce qui se passe, même s’il est difficile de connaître la situation exacte dans les pénitenciers et les prisons provinciales. Au Québec, en 2002, on a beaucoup parlé du cas de Roger Guimond, un homme épileptique qui était enfermé au pénitencier de Port-Cartier. Durant une ronde de nuit, le gardien l’a vu râlant sous son lit. Le supérieur a constitué une équipe de six personnes, avec boucliers et matraques, avant d’ouvrir la porte de la cellule, mais l’infirmier qui se trouvait avec eux n’a pas prêté secours au prisonnier. Guimond est finalement décédé, au moins deux heures après qu’on l’ait découvert. L’enquête a conclu ensuite que les gardiens avaient suivi les procédures de sécurité, et seul l’infirmier a été blâmé par son ordre professionnel. Dans le cas d’Ashley Smith, on voit sur les bandes vidéo que les autorités l’avaient isolée le plus possible, car elle dérangeait. Lorsqu’elle n’a plus respiré après s’être étranglée et qu’elle ne présentait plus de danger, ils ont ouvert la porte... Le système carcéral n’a jamais pris en compte qu’elle souffrait de problèmes de santé mentale. Dans des situations d’urgence en prison, les mesures de sécurité ont préséance sur les mesures médicales.
Comment changer la situation ?
Malheureusement, ce n’est pas un phénomène nouveau. Le droit s’arrête à la porte de la prison. En 1976, une vaste enquête sur l’ensemble des pénitenciers du Service correctionnel du Canada a eu lieu à la suite de plusieurs événements et émeutes. Une des conclusions était que ce service ne tenait pas compte des principes de droit. Vingt ans plus tard, la juge Louise Arbour a produit un autre rapport sur ce qui s’était produit dans la prison des femmes de Kingston. Elle concluait que la culture d’entreprise du Service correctionnel se situait en dehors du droit au Canada, et que l’équipe d’intervention d’urgence faisait régner la terreur dans cet établissement. L’enquêteur correctionnel, l’équivalent de l’ombudsman, fait des recommandations depuis les années 1970 pour mieux prendre en charge les détenus atteints de maladie mentale, sans que rien ne change. Les gouvernements se montrent d’ailleurs souvent incohérents. L’ancien ministre de la Justice du Québec a dénoncé la loi C-10 des conservateurs qui préconise des peines minimales plus sévères. Le nouveau ministre, quant à lui, a demandé au gouvernement Harper d’augmenter les peines pour les conducteurs avec des facultés affaiblies. C’est très hypocrite.
Que pensez-vous des pressions qui pourraient venir de l’extérieur du pays, d’organismes comme les Nations-Unies, par exemple ?
Cela n’a pas vraiment d’effet, si l’on considère le cas de la France, qui a été condamnée à de très nombreuses reprises sur la question par des instances internationales. Il faut se battre pour que l’opinion publique dénonce la situation, car les détenus ont un très faible rapport de force dans la société. Tant qu’un réel débat public sur le système pénal et le système criminel n’aura pas lieu, rien n’avancera. Toutes les autres institutions publiques ont été remises en question, sauf la justice. N’oublions pas que le pouvoir politique définit ce qu’est un crime. Ainsi, cela fait très longtemps qu’on sait qu’il existe de la corruption au Québec. Mais seule l’indignation de la population a permis qu’il y ait une enquête à ce sujet, alors que les politiciens étaient au courant. Pour que les choses changent, il faut donc absolument un débat public.