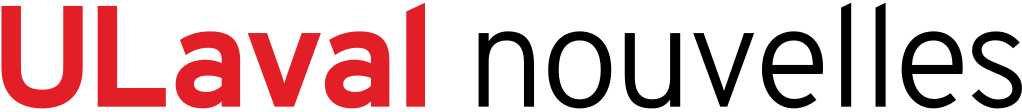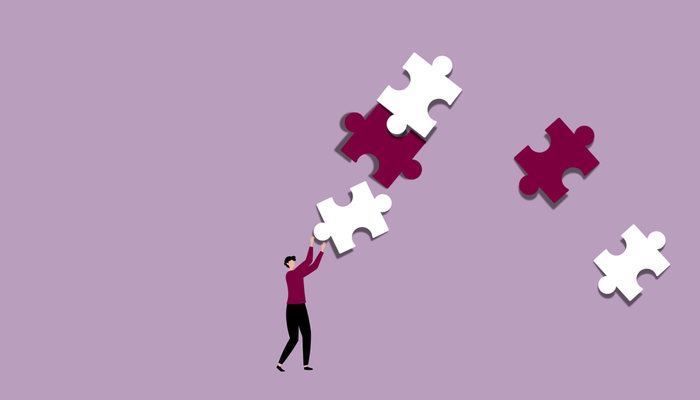Q Dans un article récent, vous rappelez qu’autrefois des chefs de parti comme John Turner, défait par les conservateurs en 1988, ou Pierre-Elliot Trudeau avaient pu rester à leur poste quelques années après un échec électoral. Pourquoi les chefs partent-ils rapidement aujourd’hui?
R Je pense qu’on est beaucoup moins indulgent à l’échec qu’on ne l’était autrefois. En plus, il existe maintenant des mécanismes de révision de leadership qui n’existaient pas auparavant. M. Dion devait faire face de toute façon à un congrès du parti qui aurait eu lieu au mois de mai prochain et qui avait toutes les chances d’être négatif. Le sachant, il a eu tendance à quitter plus vite. Dans son cas, une troisième raison s’ajoute. À tort ou à raison, on lui attribue une bonne partie de la paternité de l’échec, car sa cote comme leader était nettement plus mauvaise que celle de son adversaire. Certains croient même qu’il aurait dû démissionner et partir encore plus tôt, et non rester pour les cinq ou six prochains mois. Ce phénomène existe aussi ailleurs. En Grande-Bretagne, les quatre dernières élections ont vu le chef du principal parti défait démissionner le soir du scrutin ou le lendemain. En Australie, huit chefs sont partis sur-le-champ depuis 1972, tandis que sur les sept qui se sont cramponnés, cinq se sont fait dégommer de force! On est rendu à l’ère des chefs jetables; la vie politique est devenue plus compétitive. Si John McCain perd l’élection présidentielle américaine, il n’est plus rien…
Q D’où devrait provenir le prochain chef du PLC? De l’extérieur du parti? Du Québec? D’une autre province?
R Ce serait vraiment contre-indiqué pour un chef de venir du Québec après M. Chrétien, M. Martin, M. Dion. Par ailleurs, il vaudrait probablement mieux qu’il provienne de l’intérieur du parti et de toute façon, pour l’instant, il n’y a pas de candidat externe extraordinaire ni transcendant. Je pense qu’il n’y a pas de leader miracle. Il faut se rappeler que si Stéphane Dion a été élu comme chef malgré toutes ses faiblesses, c’est que les deux principaux candidats, Bob Rae et Michael Ignatieff, étaient perçus comme ayant de gros points négatifs. Le premier avait été une catastrophe comme premier ministre de l’Ontario et le second n’avait pratiquement pas vécu au Canada alors qu’il voulait le diriger. Ces réalités ne changent pas: Rae et Ignatieff vont avoir des problèmes. Il y a peut-être des gens qui ont attendu pour passer leur tour après la défaite électorale. C’est sans doute le calcul de Manley et de McKenna notamment, absents de la course en 2006.
Q Comment le Parti libéral du Canada peut-il redevenir un parti de gouvernement comme il l’a été si longtemps?
R Il faudrait d’abord que le gouvernement en place se casse la figure. C’est de cette façon que les libéraux sont venus au pouvoir à bien d’autres occasions. La crise économique, si elle s’aggrave et si elle se prolonge, va certainement aigrir les gens contre les conservateurs et favoriser les libéraux. Cela peut être aussi bête que ça; une espèce de retour du balancier. On dit toujours au Parti libéral qu’il lui faut être plus nationaliste au Québec. Pourtant, M. Harper l’a fait et le Québec n’a pas eu l’air de lui en savoir gré beaucoup. De toute façon, le Bloc québécois gagne à tous les coups la course du plus nationaliste. Par ailleurs, le Parti libéral n’a pas grand-chose à espérer de l’Ouest où les conservateurs sont bien implantés. Par contre, c’est essentiel pour les libéraux de reconquérir l’Ontario s’ils veulent emporter de prochaines élections. Cela va être plus difficile à obtenir, car la droite n’est plus divisée en deux courants, le Reform Party et les conservateurs, comme dans les années 1990. Il n’y a pas de recette miracle cependant. Je pense essentiellement que la recette du retour c’est que le gouvernement se casse les dents sur la crise économique. De plus, si Obama devient président, cela va déplacer l’axe politique vers la gauche.