3 décembre 2008
Pour un campus responsable et équitable
L’Université se dote d’une politique institutionnelle de développement durable qui s’articule autour des opérations quotidiennes, des activités d’enseignement et de recherche, et de l’engagement des membres de la communauté
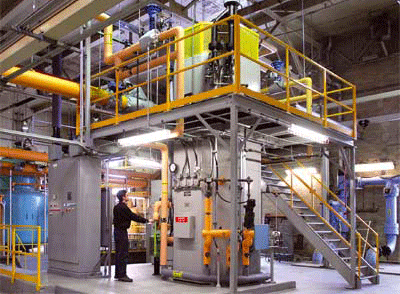
Le Service des immeubles a ajouté une chaudière électrique au système de chauffage de l'Université, générant des économies de factures d'énergie de 15 000 $ à 50 000 $ par mois et une réduction annuelle estimée de 20% des émissions de gaz à effet de serre produits par le système de chauffage.
— Marc Robitaille
La Politique a pour but de «bâtir pour et avec ses membres, un avenir durable, responsable, dans un souci d’équité intra et intergénérationnelle». Elle s’articule autour de trois axes d’intervention. L’un d’eux consiste à intégrer la notion de développement durable dans les orientations institutionnelles et dans les activités de l’Université qui touchent à la formation, l’apprentissage, la recherche et la diffusion des connaissances. «L’Université offre au-delà de 130 cours où l’on véhicule la notion de développement durable, indique Éric Bauce. Nous avons aussi plus de 100 projets de recherche qui traitent de développement durable, ainsi qu’un institut, l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société. Nous avons comme objectif d’intégrer cette notion dans l’ensemble de la formation.»
Pérenniser la qualité de vie
Le développement durable consiste à répondre aux besoins actuels de la société sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. À cette définition un peu abstraite, le vice-recteur exécutif et au développement propose une définition plus proche de la personne. «Le développement durable, souligne Éric Bauce, comprend trois aspects: l’économique, l’environnemental et le social. On peut ramener ces aspects au niveau de vie, au milieu de vie et au cadre de vie. On concentre ça pour arriver à une finalité: la qualité de vie. Ce n’est qu’en intégrant ces trois composantes qu’on peut en venir à assurer une pérennité de la qualité de vie.»
Un des enjeux sociaux de la Politique consiste à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration de la qualité du milieu de travail, d’étude et de vie à l’Université. Les enjeux économiques visent à acquérir des biens et services en tenant compte, entre autres, de leur cycle de vie afin de minimiser leur empreinte écologique. Ils visent aussi à intégrer la notion de développement durable dans les plans de développement du patrimoine naturel, immobilier, culturel et intellectuel de l’Université. Quant aux enjeux environnementaux, ils consistent à gérer la consommation d’eau de façon responsable, à favoriser l’efficacité énergétique, l’économie d’énergie et l’utilisation de sources d’énergie faibles en émissions de gaz nocifs et polluants, et à assurer une qualité optimale de l’air en limitant la quantité de gaz à effet de serre et des autres gaz nocifs émis.
La Politique prévoit faire du campus une sorte de banc d’essais pour de nouvelles approches ou technologies qui pourraient modifier certaines façons de faire dans une optique de développement durable. Une de ces approches est la norme LEED. Elle s’applique, sur le campus, aux projets de rénovation et de construction dont la valeur est supérieure à 3 millions de dollars. «Cette approche a été appliquée au pavillon Gene-H.-Kruger, explique Éric Bauce. Ce bâtiment conçu en bois d’ingénierie consomme environ 25 % moins d’énergie qu’un édifice en béton de dimensions semblables. Si ça marche sur le campus, ça peut marcher ailleurs.» Le Programme d’efficacité énergétique en cours est un autre exemple. Assorti d’un budget de 12 millions de dollars, il prendra fin en 2012. «On parle d’économies énergétiques d’environ 3 millions de dollars par an, poursuit le vice-recteur. En bout de ligne, ça pourrait représenter une réduction de l’ordre de 50 % de nos émissions de gaz à effet de serre.»
Un plan d’action biennal
Le suivi de la Politique se fera par un plan d’action biennal, en lien avec les trois axes d’intervention. Ce plan comprendra des cibles institutionnelles et des indicateurs de performance. Un de ces indicateurs sera l’étude en cours visant à établir le bilan complet des émissions de dioxyde de carbone (CO2) dans la cité universitaire.
À ce jour, la Table de concertation sur le développement durable a donné son aval pour la réalisation d’une vingtaine de projets soumis par les membres de la communauté universitaire. Le Fonds de développement durable a assuré ou assure leur financement. Neuf d’entre eux sont complétés, onze sont en voie de réalisation. Parmi les premiers, mentionnons le récent Salon Motivation-Santé où des étudiants en sciences de la santé ont informé le grand public sur les bienfaits de la prévention. Il y a aussi la conversion du magazine Contact au papier 100 % recyclé et l’aménagement du jardin de la maison de l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS). Au nombre des projets en voie de réalisation, mentionnons l’équipe verte du Service des immeubles qui fait de la sensibilisation itinérante auprès de la communauté universitaire, entre autres, en ce qui concerne la collecte multimatières. Il y aussi la brochure Une empreinte durable dans le monde, ainsi que le projet de tasses réutilisables qui est en marche depuis octobre. «Nous voulions réduire la consommation de tasses en styromousse sur le campus, indique Éric Bauce. Nous avons financé une partie du coût de fabrication des tasses. Elles sont faites de plastique recyclé et vendues à faible coût aux étudiants.»
Dès 1994, Laval s’est dotée d’une politique de protection et de promotion de l’environnement. La même année, elle était la première parmi les universités québécoises à implanter un programme de récupération multimatières. En 2006, près de 750 tonnes de résidus ont été recyclées. Grâce à l’installation, en 2007, d’une nouvelle chaudière à vapeur utilisant l’électricité, l’Université a réduit de près de 20 % les émissions de gaz à effet de serre causées par le chauffage. Aujourd’hui, près de 90 % des notes de cours et 75 % des documents administratifs sont imprimés recto verso. En avril 2008, les résidences étudiantes du campus ont obtenu la certification Établissement vert Brundtland, une première pour les lieux d’hébergement universitaires au Québec. En mai, 720 usagers étudiants faisaient appel au programme de covoiturage AlterÉco.
«Depuis un certain nombre d’années, souligne Éric Bauce, Laval a accompli beaucoup d’actions en développement durable qui donnent des résultats. On sent que l’Université est pionnière, pas en termes de discours, mais de réalisations. Et au niveau des actions, nous n’avons pas grand-chose à envier aux autres universités au Québec.»
Le texte de la Politique est disponible à l’adresse suivante: www.developpementdurable.ulaval.ca.


























