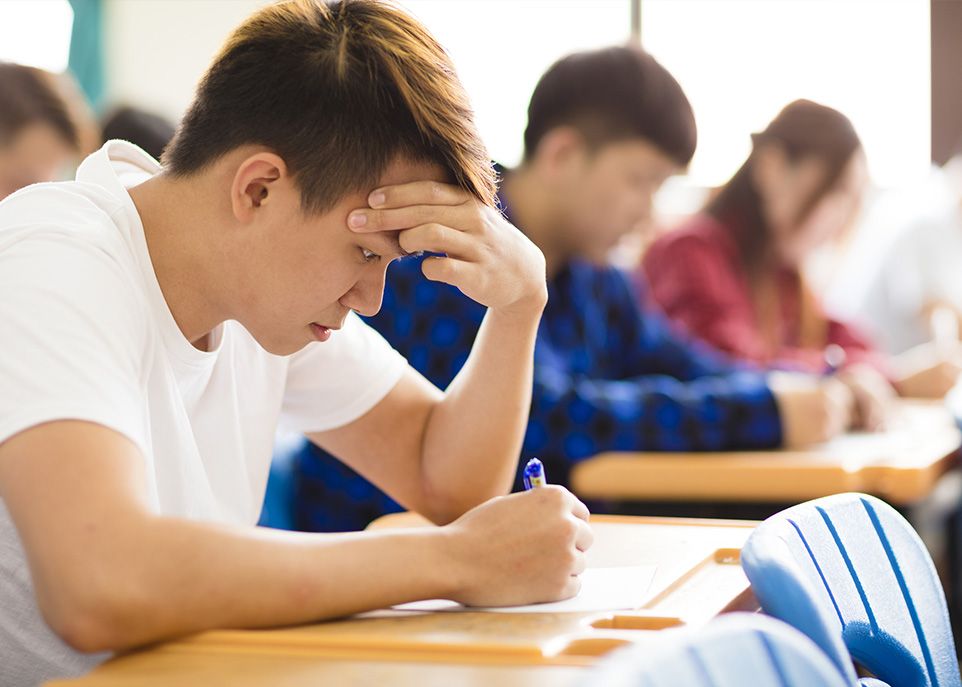
Comment un médecin peut-il distinguer un TDAH d’origine biologique, donc traitable par un médicament, de celui causé par les conditions de vie de l’enfant?
Le TDAH se définit comme un syndrome causé par certaines anomalies neurobiologiques. Il n’a donc rien à voir avec l’environnement. Sauf que le milieu dans lequel vit l’enfant peut amener des symptômes qui ressemblent à ceux du TDAH. Un divorce, des difficultés familiales chez un enfant potentiellement anxieux, le manque de nourriture à la maison amènent certains à être plus agités. À l’école, l’élève aura tendance à bouger plus et à être plus dérangeant. Cela peut faire croire au médecin ou au praticien qu’il s’agit d’un TDAH, alors que ce n’est pas le cas. Une des difficultés, c’est que pour savoir si l’enfant souffre ou non d’un tel syndrome, il faut disposer de l’information juste sur le patient. Cela suppose qu’on peut avoir accès autant aux évaluations scolaires et à l’histoire familiale qu’aux interventions en psychologie et en neuropsychologie, réalisées avec des batteries de tests standardisés. Rien que cette évaluation coûte aux parents autour de 1 000 dollars. Il est donc très difficile actuellement au Québec de disposer de ces services. Le gouvernement du Québec vient d’annoncer la mise sur pied de centres de développement pour les 0 à 5 ans. Dans l’avenir, ces centres pourront peut-être aider à dépister des cas potentiels plus tôt.
Quels sont les risques pour l’enfant ne souffrant pas d’un tel syndrome de prendre un médicament contre le TDAH?
Globalement, les psychostimulants sont sécuritaires et efficaces. Pris à long terme, ces médicaments semblent cependant avoir un effet sur la croissance. Il se peut que les enfants traités soient plus petits d’un ou deux centimètres par rapport à leur potentiel génétique. Il reste que les médecins doivent établir le bon diagnostic pour le bon patient et le traiter de la bonne manière. Certains font valoir que la prise de ce médicament peut aider l’enfant à mieux écouter en classe et peut-être à avoir de meilleurs résultats scolaires. Or, en agissant ainsi, on utilise une «béquille» pour combattre la mauvaise maladie. Il est possible que l’enfant ait davantage besoin d’une aide psychologique plutôt que d’un médicament pour l’aider à affronter des problèmes de comportement, de compulsion, d’anxiété ou autres. Les études effectuées un peu partout dans le monde montrent qu’environ 5 à 7% des enfants souffrent de TDAH. Or, au Québec, trois fois plus de jeunes sont traités pour ce syndrome. Pourquoi un tel écart? Il faudrait mener davantage de recherches pour le savoir.
Justement, que peuvent faire les médecins pour éviter les faux diagnostics et mieux répondre aux besoins des enfants?
Il s’agit d’un problème qui dépasse largement le monde médical. Est-ce que les écoles offrent un environnement adapté aux besoins des élèves ou ces derniers doivent-ils se conformer au système défini par les adultes? À titre d’exemple, la maturité neurologique varie beaucoup selon les enfants. Dans une classe, deux élèves du même âge physiologique peuvent avoir des capacités d’attention très différentes, car ils n’auront tout simplement pas la même maturité. Cela peut jouer sur la justesse des diagnostics. Il s’agit d’un problème très complexe qui ne concerne pas seulement l’école, mais touche à notre fonctionnement comme société. Dès le lever, on presse nos enfants pour les amener à la garderie ou à l’école avant d’aller travailler. Ils ont à peine le temps de dîner, puis ils vont un peu dehors et rentrent en classe. Nos enfants ont un rythme de vie assez stressant si on le compare à celui d’il y a 30 ans ou 40 ans. Nous vivons dans une société où la performance et même l’ultra-performance sont valorisées. J’ai l’impression qu’il faudrait revoir nos modèles de fonctionnement.


























