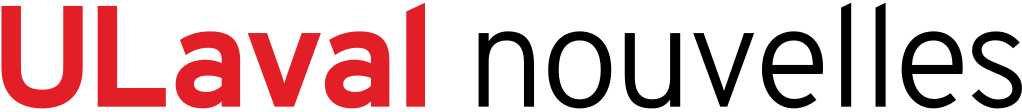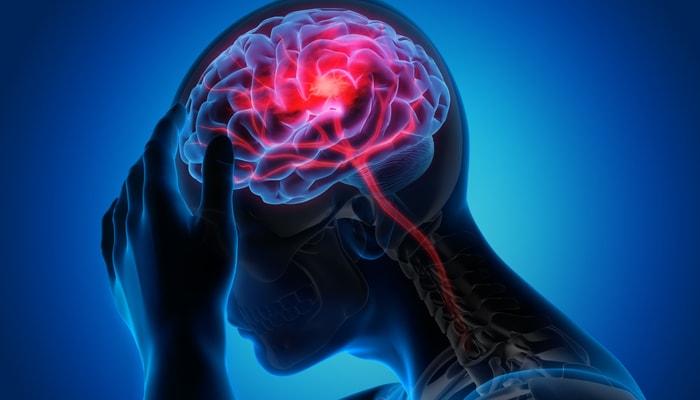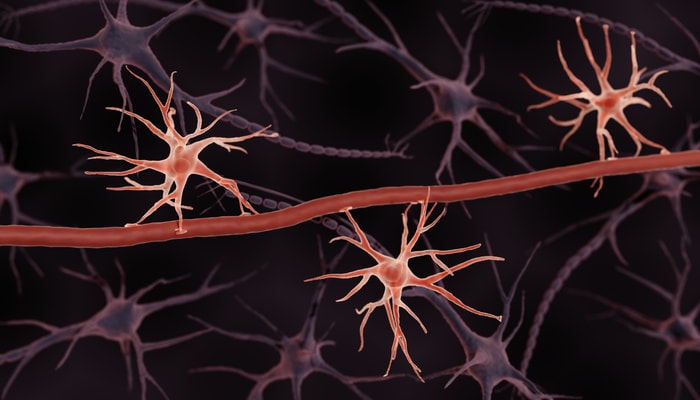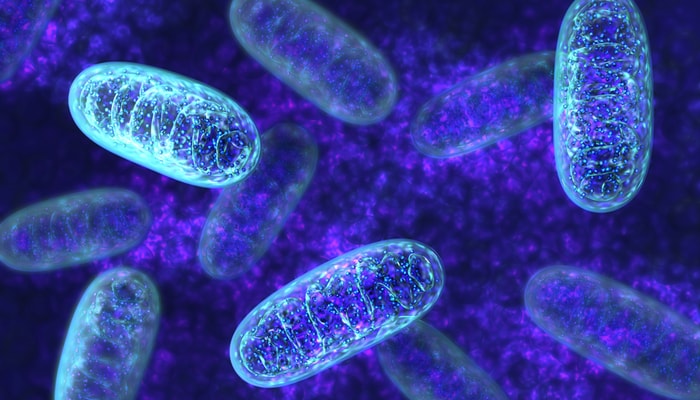L'abeille cotonnière, Anthidium manicatum, fait partie des abeilles sauvages qui vivent au Québec.
— Frank Vassen
L’apiculture urbaine gagne sans cesse en popularité, mais une question se pose: cette activité porte-t-elle atteinte aux populations d'abeilles sauvages qui vivent en ville? Pas forcément, répondent des chercheurs de l'Université Laval et de l'Université de Montréal qui se sont penchés sur la question. Leur analyse, qui vient de paraître dans la revue Urban Ecosystems, conclut qu'une coexistence sereine entre ces pollinisateurs est possible, à condition que la densité de ruches reste sous un certain seuil et que les ressources florales soient au rendez-vous. Dans certaines villes, ce seuil est malheureusement déjà franchi, précise la responsable de l'étude, Valérie Fournier, du Département de phytologie et du Centre de recherche et d'innovation sur les végétaux de l'Université Laval.
Il existe environ 20 000 espèces d'abeilles sauvages dans le monde, dont près de 350 vivent au Québec. À l'exception des bourdons et de quelques espèces semi-sociales, les abeilles sauvages qu'on trouve ici sont solitaires et souvent de petite taille, de sorte qu'elles passent inaperçues, précise la professeure Fournier. Elles jouent pourtant un rôle important dans la pollinisation et la survie des plantes indigènes en milieu naturel. «Plusieurs études ont déjà rapporté que les abeilles domestiques ont des effets négatifs sur la diversité et l'abondance des pollinisateurs sauvages en milieu agricole et en milieu naturel. Nous voulions savoir si c'était également le cas en milieu urbain», explique la chercheuse.
Pour répondre à cette question, les chercheurs ont étudié 25 sites – 5 parcs, 9 cimetières et 11 jardins communautaires – de la région métropolitaine de Montréal en 2012 et 2013. Lors de ces deux années, l'aire d'étude abritait respectivement 158 ruches et 238 ruches. Pour estimer l'abondance des abeilles domestiques et sauvages, les chercheurs ont utilisé des bols de différentes couleurs qu'ils ont remplis d'eau savonneuse dont ne peuvent s'échapper les insectes qui y posent les pattes. Cette technique leur a permis de capturer 19 000 spécimens dans les 25 sites. Pour compléter leur récolte de données, ils ont mesuré l'abondance des ressources florales qu'on trouvait dans chacun des sites entre avril et septembre.
Au terme de leurs analyses, les chercheurs concluent que, au moment de l'étude, rien n'indiquait que les abeilles domestiques nuisaient aux abeilles sauvages. Par ailleurs, tel qu’ils l’avaient prévu, l'abondance des ressources florales a un effet positif sur les populations d'abeilles sauvages.

Comment aider sans nuire
«Notre étude montre que les villes peuvent abriter d'importantes populations d’abeilles sauvages lorsque les ressources florales sont suffisantes et que la densité d'abeilles domestiques reste modérée, résume la professeure Fournier. Il faut toutefois s’assurer que la densité des ruches demeure sous le seuil à partir duquel la compétition risque de se produire. À Paris, ce seuil est maintenant dépassé. Ça pourrait aussi être le cas sur l'île de Montréal parce que la densité des ruches y est maintenant presque cinq fois plus élevée qu'en 2013.»
— Valérie Fournier
L'installation de ruches dans les villes a la cote par les temps qui courent, notamment parce que les gens y voient une façon d'aider les abeilles domestiques, souligne la chercheuse. «Il ne faut pas oublier que l'installation d'une seule ruche ajoute au minimum 5000 ouvrières dans un secteur. Si on veut aider les abeilles domestiques sans nuire aux abeilles sauvages, il faut planter des fleurs et laisser pousser les pissenlits.»
Les chercheurs de l'Université Laval qui signent l'article paru dans Urban Ecosystems sont Frédéric McCune et Valérie Fournier, du Département de phytologie, et Marc Mazerolle, du Département des sciences du bois et de la forêt et du Centre d'étude sur la forêt. L'autre signataire est Étienne Normandin, du Département des sciences biologiques de l'Université de Montréal.