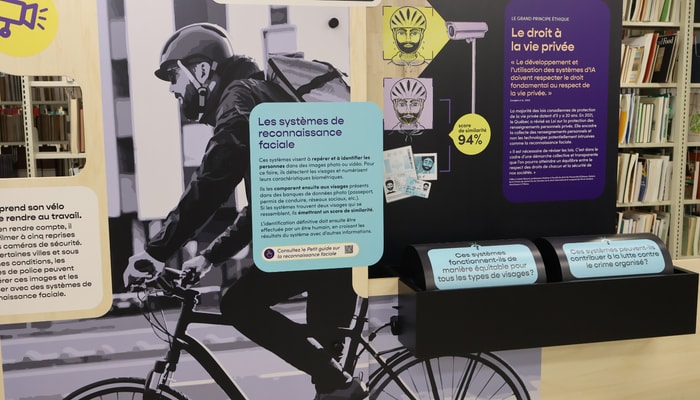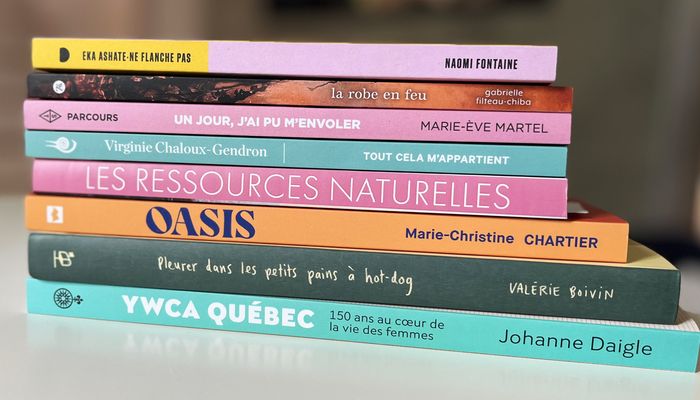L’église Saint-Nonna de Penmarch, en Bretagne. De forme rectangulaire, cet édifice bâti à partir de 1508 possède une grande tour inachevée. Des arcs ogivaux épaulent la nef centrale. Les fenêtres sont différentes en emplacement, en dimensions et dans les réseaux pour les vitraux. Les chapelles latérales sont en saillie et le chevet plat, au fond du chœur, s’admire de l’extérieur.
— Chris06
Les Presses universitaires du Septentrion, de Lille, viennent de rééditer L’Architecture flamboyante en France, une œuvre majeure écrite par le professeur d’histoire de l’art Roland Sanfaçon et publiée aux Presses de l’Université Laval en 1971.
«Le livre de 1971 faisait 219 pages, celui-ci en compte 564, explique ce spécialiste de l’art médiéval aujourd’hui retraité. Rien n’a été changé au texte d’origine. L’ouvrage contient toutefois un chapitre supplémentaire que j’ai écrit, qui apporte des précisions et d’autres considérations.»
Ce livre un peu spécial est enrichi d’une réflexion critique autour de l’ouvrage de 1971, une réflexion alimentée par les articles de plusieurs experts internationaux, dont une préface de Martin Pâquet, professeur au Département des sciences historiques à l'Université Laval.
«La contribution de l’éditrice Stéphanie Diane Daussy, poursuit-il, est irremplaçable: longue présentation expliquant le contexte où le livre a été écrit en 1971, correction de tous les textes soumis, rénovation de l’illustration, bibliographie des ouvrages parus sur le sujet de 1971 à nos jours, un index exhaustif lieux, personnes pour l’ensemble du volume.»
L’Architecture flamboyante en France, sous-titrée Autour de Roland Sanfaçon, rend hommage à un essai vite devenu la principale référence sur une période méconnue de l’histoire de l’architecture gothique française comprise entre les années 1380 et 1540. En l’absence d’une synthèse française équivalente, ce livre demeure encore aujourd’hui un ouvrage pionnier.
Dans sa préface, le professeur Pâquet rappelle le séjour d’étude du professeur Sanfaçon et de ses étudiants en France en 1970. Les quelques milliers de photos et de diapositives rapportées de ce voyage allaient constituer le corpus documentaire du livre.
«J’avais déjà en tête le projet de livre avant d’effectuer ce voyage, raconte Roland Sanfaçon. Dans mon ouvrage, j’analyse et j’interprète les églises et les cathédrales que j’ai visitées. À cette époque, en France, les historiens d’art documentaient ces édifices sans chercher à les interpréter. Il faut dire que dans ce pays, la fin de la période gothique était regardée comme une sorte de décadence. Je me suis toujours inscrit en faux contre cette perception. Cette très longue période a vu la construction d’au moins le tiers des monuments religieux en France. Les architectes de ce temps vivaient dans une société où s’affirmaient la valorisation de l’individu et la liberté. Ils sont inventifs et explorent des voies nouvelles.»
À la recherche d’un nouveau classicisme
Dans son livre, le professeur Sanfaçon souligne le fait que les bâtiments du gothique flamboyant s’inscrivent, en partie du moins, dans la continuité des formidables cathédrales construites entre 1140 et 1240, telles que Chartres, Reims ou Amiens. «L’architecture flamboyante, écrit-il, comporte un retour aux éléments puissants du gothique rayonnant, aux piliers massifs, aux grands murs nus.» En même temps, les architectes font une recherche passionnée d’un nouveau classicisme. Les portails sont amples, la fenêtre centrale prend plus d’importance, les contreforts présentent une nouvelle conformation. «À cette époque, poursuit-il, on “écoute” la technique de construction. Si on considérait qu’une fenêtre devait avoir telle hauteur et, ce faisant, se différenciait des autres, elle avait telle hauteur. On suit les disponibilités techniques du monument sans oublier les fusions dans l’espace de l’édifice. Au temps du gothique classique, autour de 1200, on tendait vers l’unité, la symétrie. On voulait des fenêtres partout dans un même bâtiment et toutes avaient les mêmes dimensions.»
Selon le professeur, par contraste, les édifices de la période flamboyante permettent de comprendre l’architecture du 13e siècle. «Par exemple, dit-il, ces petites colonnettes du gothique rayonnant, qui descendent jusqu’au bas des piliers, sont trompeuses. Elles donnent l’impression que les voûtes reposent sur elles, alors qu’en fait elles s’appuient sur les gros piliers. Le gothique flamboyant évite ces impressions. On est très franc.»
L’architecture flamboyante se distingue des périodes précédentes, entre autres par sa décoration. «Durant mes visites, indique Roland Sanfaçon, j’ai constaté dans plusieurs cas une décoration moins exubérante que celle des églises et cathédrales des 12e et 13e siècles. Sur ces édifices plus anciens, j’ai souvent remarqué une formation triangulaire au-dessus du portail, une formation décorée de petits éléments tout du long. À l’époque du flamboyant, on n’en met que deux ou trois qui sont beaucoup plus développés. Au fond, chaque élément décoratif des portails du flamboyant reçoit une forme particulière. Souvent, cet élément contraste avec la forme d’à côté. Comme une façon d’attirer l’attention.»
Selon lui, les sculpteurs en ces lieux faisaient de même en essayant de varier le visage de leurs personnages. «On voulait que chaque personnage se distingue de l’autre, explique le professeur. Sur les grands portails du 13e siècle, tous les personnages sont à peu près identiques. En termes de société, on pourrait peut-être parler aux 15e et 16e siècles d’une reconnaissance des différences entre les personnes, qui acceptent pourtant de bien faire partie de leur communauté.»
Normandie, Bretagne, Bourgogne, plusieurs régions de France possèdent de beaux exemples d’architecture flamboyante avec des caractéristiques régionales propres. «L’architecture bourguignonne de cette époque, souligne-t-il, est assez différente de celle de la région de Paris. Même chose pour la Normandie.»

L’église Saint-Séverin, à Paris. L’édifice possède des vitraux de la fin du 15e siècle. Les piliers ont des formes et des décors variés contrastant aussi avec les moulures prismatiques des nervures sous les voûtes, le tout dans une interpénétration et une participation forte à l’ensemble construit. Noter la colonne torsadée au second plan.
— Roland Sanfaçon

L’église Saint-Luc dans la ville de La Chapelle Saint-Luc, département de l’Aube. Son intérieur est d’une grande sobriété. Cet édifice a été entrepris en 1513.
— Roland Sanfaçon