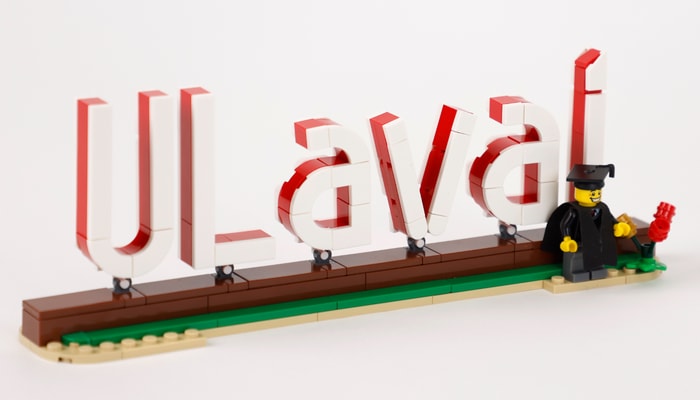«En plus d’être une science mathématique, l’économie est une science des choix économiques basée sur la répartition des richesses. De son côté, la morale est l’art de faire des choix et de distinguer la raison de la passion», a expliqué le conférencier. Toute la question réside selon lui dans le fait de savoir comment l’économie peut contribuer au bonheur commun. Dans un ouvrage récent, Le code pour une éthique globale. Vers une civilisation humaniste (Éditions Liber), il édicte dix règles pour un monde économique meilleur. La première concerne la dignité humaine et l’égalité qui lui est inhérente. Le respect de la vie et de la propriété arrive en deuxième position: «On ne peut pas échanger si on ne possède rien et la propriété doit servir au bien commun.» Puis viennent la tolérance, le partage («Il faut compenser pour ceux qui n’ont pas eu la chance de naître riches ou intelligents») ou encore la préservation des ressources naturelles de la Terre. Des règles humanistes dont il aimerait que les modèles économiques s’inspirent davantage.
Aux yeux de Rodrigue Tremblay, aucun des trois grands modèles économiques actuellement en vigueur n’est satisfaisant. Il considère que le capitalisme à l’américaine, avec son dogme voulant que la fluctuation des prix résolve les problèmes, comme une grossière erreur. «Laisser fonctionner les marchés sans réglementation est un désastre. Il n’y a qu’à voir la période de récession dans laquelle les États-Unis sont plongés pour s’en convaincre.» Le modèle social-démocrate européen ne vaudrait pas beaucoup mieux: «Il est meilleur que le capitalisme, mais les sociétés qui l’ont choisi se demandent aujourd’hui comment elles vont payer les pensions.» Quant au modèle politico-religieux, tel celui de l'Iran, il le condamne pour sa dangerosité. «On assiste à une fuite vers la religion qui découle de l’échec du socialisme, du communisme, de la social-démocratie ou du capitalisme.» S’il reconnaît qu’il est important de tenir compte des besoins que les religions satisfont, Rodrigue Tremblay croit cependant que le fait d'être religieux jusqu'au fanatisme équivaut à ne pas être moral. «Les religions proposent une moralité de groupe et elles placent l’Homme au centre de l’univers, déplore-t-il. Elles opposent la moralité individuelle à celle de la sphère publique et elles sont imprégnées de notions telles que le paradis ou l’enfer.» Il est donc convaincu qu’une mondialisation harmonieuse devra reposer sur les grands principes de morale humaniste. Principes qui sont parfois innés et qui peuvent aussi, selon lui, s’acquérir avec l’éducation.».