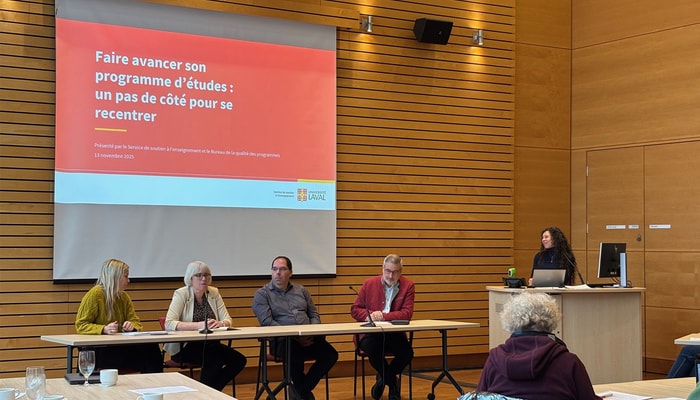Le déploiement d'un nouveau site de recherche et d'enseignement, en remplacement de l'actuel pavillon Paul-Comtois, est un incontournable dans la stratégie de modernisation du secteur agroalimentaire au Québec, selon la direction.
— Dany Vachon
L'Université Laval franchit une étape majeure dans son appui à la transformation du secteur agroalimentaire au Québec. Elle dévoile une stratégie ambitieuse pour soutenir et contribuer aux objectifs québécois de souveraineté alimentaire avec le déploiement d'un nouveau pôle agro-tech.
L'Université Laval est déjà pleinement engagée dans la modernisation du secteur agroalimentaire grâce à l'implication d'une communauté de 1200 personnes issues de la recherche et de l'enseignement ainsi que du personnel technique et de soutien.
Elle entend aller encore plus loin avec le déploiement d'un nouveau pôle agro-tech. C'est un levier essentiel pour accompagner les personnes actives dans le milieu agroalimentaire dans l'évolution de leurs pratiques et le développement de solutions durables. «Cette initiative renforcera notre appui aux milieux agricoles et alimentaires, notamment par l'accueil de nouvelles professeures et de nouveaux professeurs, le développement de partenariats stratégiques et la création d'un agro-tech — un site de formation et de recherche à la fine pointe des technologies et des savoirs, voué à une agriculture innovante, prospère et durable», explique Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval.
Ce projet vise aussi à former la prochaine génération de professionnelles et de professionnels hautement qualifiés en agronomie, en transformation alimentaire et en nutrition, afin de répondre aux besoins critiques de main-d'œuvre au Québec et de pallier le vieillissement de la profession d'agronome. Il mettra, entre autres, l'accent sur les technologies de pointe, telles que la robotisation et l'intelligence artificielle, pour préparer les étudiantes et les étudiants aux défis futurs du secteur bioalimentaire, caractérisés par la complexification des méthodes de production et la demande croissante en aliments de qualité.
C'est un projet majeur pour l'Université qui possède la seule faculté francophone des sciences de l'agriculture et de l'alimentation (FSAA) en Amérique du Nord. Cette faculté est reconnue à l'international et elle est parmi les plus performantes en recherche au Canada. De plus, elle forme 85% des agronomes au Québec.
«La FSAA est à un moment charnière de son développement stratégique alors que le Québec vise à développer son autonomie alimentaire. Nous devons propulser notre secteur économique agroalimentaire vers le futur. L'accroissement de l'offre alimentaire au Québec passe par l'exploration d'approches innovantes comme la culture en serre, l'agriculture verticale et les nouveaux procédés alimentaires, et par le transfert et l'intégration des connaissances jusqu'à la ferme. Il est essentiel de se doter de milieux de formation et de laboratoires d'envergure pour la recherche et réaliser des avancées technologiques», soutient Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation.
Des propos corroborés par le doyen de la FSAA, Denis Roy. «Nous avons entrepris un virage stratégique pour se positionner comme un acteur incontournable dans le secteur de l'agriculture 5.0 et de l'alimentation 4.0, ce qui fait référence à l'évolution de ces secteurs vers une utilisation intensive des technologies. On parle même d'une révolution technologique qui améliorera la sécurité alimentaire, la productivité des secteurs, tout en réduisant l'empreinte écologique des activités liées au secteur agroalimentaire et en favorisant la conservation des sols. Pour y arriver, il est essentiel de poursuivre la concertation interdisciplinaire et de pouvoir compter sur des laboratoires d'enseignement et des infrastructures de recherche à la fine pointe. L'application des nouvelles technologies ouvre de nombreuses possibilités en recherche.»
Dans ce contexte, l'implantation d'un nouveau site de recherche et d'enseignement est incontournable pour déployer la stratégie. «C'est dans cet esprit que nous poursuivrons les discussions amorcées il y a plus de deux ans avec le ministère de l'Enseignement supérieur (MES) pour faire inscrire dans le plan québécois des infrastructures la construction d'un nouveau pavillon des sciences de l'agriculture et de l'alimentation pour remplacer le pavillon Paul-Comtois, actuellement le plus vétuste du campus», ajoute Sophie D'Amours. Le projet est évalué aujourd'hui à la hauteur d'environ 300 M$.
En plus d'être moins coûteuse qu'une rénovation, cette orientation permettrait de poursuivre les efforts entrepris pour ajouter plus de 200 logements étudiants sur le campus en transformant le pavillon Paul-Comtois laissé vacant en résidences étudiantes autofinancées.
Des 40 projets d'infrastructures du secteur de l'Enseignement supérieur inscrits au PQI 2024-2034, la région de la Capitale-Nationale en compte un seul, mais aucun pour l'Université Laval. Le dernier projet majeur de l'Université Laval soutenu par le MES remonte à plus de 20 ans.
Le pavillon de 18 000 m² envisagé deviendrait un pôle d'excellence francophone dans la Ville de Québec. Son potentiel d'attraction favorisera le regroupement stratégique des meilleurs talents des domaines agroalimentaires.
«C'est un projet qui aura un impact pour la ville de Québec et l'ensemble du Québec. La proposition déposée par l'Université Laval auprès du ministère de l'Enseignement supérieur constitue une opportunité structurante pour la Ville de Québec avec des retombées pour l'ensemble du Québec. Le projet est mûr. Nous devons nous donner les moyens de le réaliser. De plus, nos ambitions sont en phase avec celles de la nouvelle politique bioalimentaire nationale, qui vise à accroître l'autonomie alimentaire du Québec, à développer un secteur prospère et durable et à accélérer l'innovation dans le secteur bioalimentaire», conclut Sophie D'Amours, en référence aux propos tenus il y a quelques jours par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne.