
Au Québec, pourquoi appelle-t-on les tamias rayés des petits «suisses»… alors qu'ils n'ont rien à voir avec la Suisse? D'où vient le mot «bobette», pour désigner un sous-vêtement? Les capsules linguistiques de la série Dis-moi pas!? La petite histoire des mots d'ici expliquent l'origine de certains termes utilisés chez nous et déboulonnent plusieurs mythes avec humour, cet été à Télé-Québec. Ces courtes vidéos, diffusées les mardis et les dimanches, sont le fruit des travaux menés au Trésor de la langue française au Québec (TLFQ).
«On est en train de produire une deuxième saison qui sera télédiffusée à partir de la semaine du 18 septembre, le samedi et le dimanche, quelques minutes avant midi», indique Robert Vézina, directeur du TLFQ, un groupe de recherche sur le français québécois, qui relève du Département de langues, linguistique et traduction de l'Université Laval.
La narration a été confiée à l'humoriste Charles Beauchesne, récompensé au Gala Les Oliviers pour son balado Les pires moments de l'histoire. «On arrive avec le scénario final, il se l'approprie, il est excellent. On a du fun pour les enregistrements!» lance Robert Vézina, tout en ajoutant que ces segments d'environ trois minutes et trente secondes demandent beaucoup de travail en amont et que toute une équipe multidisciplinaire y est à l’œuvre.
Il s'agit pour lui d'un aboutissement. Il rêvait déjà de faire ce genre de vidéos quand il était étudiant et auxiliaire de recherche au TLFQ, au tournant des années 1980 et 1990. «Dans les soupers de famille ou d'amis, à l'époque, les gens se demandaient: qu'est-ce que ça mange en hiver, quelqu'un qui étudie en linguistique? Quand je racontais l'histoire de tel mot, qui venait de tel autre mot, et pas nécessairement de l'anglais, je me rendais compte de l'intérêt que ça suscitait.»
Saut dans le temps, en prenant la relève du TLFQ, il a obtenu une subvention de 4,5M$ sur trois ans du gouvernement du Québec, qui lui a permis de réaliser plusieurs projets, dont cette série qui se retrouve aussi dans son intégralité sur les sites Web du TLFQ et de Télé-Québec.
Le souci d'étonner
«On veut piquer la curiosité des Québécois et des Québécoises pour leur propre langue, indique Robert Vézina, leur montrer à quel point elle a une histoire riche, complexe et parfois étonnante, et que ce n'est pas un français isolé dans le monde. Dans les capsules, on voit les liens qu'on peut établir avec d'autres variétés de français, celui de France, du Canada francophone, de la Louisiane, des Antilles françaises.»
— Robert Vézina
Parmi les mots choisis par Robert Vézina, il y a aussi des emprunts à l'anglais, à la langue basque, comme barachois ou orignal, aux langues autochtones, comme atoca.
Au cours des ans, les recherches dans le domaine de la lexicologie historique ont permis à l'équipe du TLFQ de déconstruire des hypothèses tenaces, qui ne sont que des légendes. Le bonhomme Sept-Heures, par exemple, ne vient pas de bone setter (ramancheur en anglais), apprend-on dans la capsule.
«On travaille des mots extraordinaires, comme quétaine pour la saison 2», révèle le directeur du TLFQ, en ajoutant qu'il y avait beaucoup de choses à démêler à ce sujet et que des gens vont tomber en bas de leur chaise en apprenant la petite histoire.
Générer de la fierté
Des fois, le point d'allumage d'un mot est l'idée d'une seule personne, mentionne Robert Vézina. «Ça germe dans la tête de quelqu'un et par toute sorte de processus, ça se répand dans la population qui l'adopte.» Enfirouaper est notamment né sous la plume d'Hector Berthelot avocat, journaliste, humoriste et éditeur du 19e siècle. Enfifrewâper, dans sa variante la plus ancienne, signifiait «tromper, duper, berner», nous apprend le Dictionnaire historique du français québécois, ouvrage au cœur des travaux du TLFQ sur lequel reposent la plupart des capsules.
«La série Dis-moi pas?! nous montre la vie de la langue, à quel point elle est organique. Quand on se l'approprie, quand on l'aime et quand on essaie de la maîtriser, on peut influer sur son évolution», croit Robert Vézina. Pour assurer la pérennité de la langue française au Québec, le TLFQ a décidé de montrer ses aspects les plus étonnants pour que les gens soient fiers de la parler, poursuit-il.
Outil pédagogique
Son groupe de recherche prépare par ailleurs du matériel pédagogique pour accompagner les capsules vidéo et aider les enseignants de français à les utiliser en classe.
En plus de remonter à l’origine des mots, la série diffuse des notions historiques intéressantes. « J’ai un souci pour ça. Je m’efforce d’évoquer de façon pertinente des personnages historiques, tant hommes que femmes. La saison 2 est très éloquente à cet égard », souligne Robert Vézina.
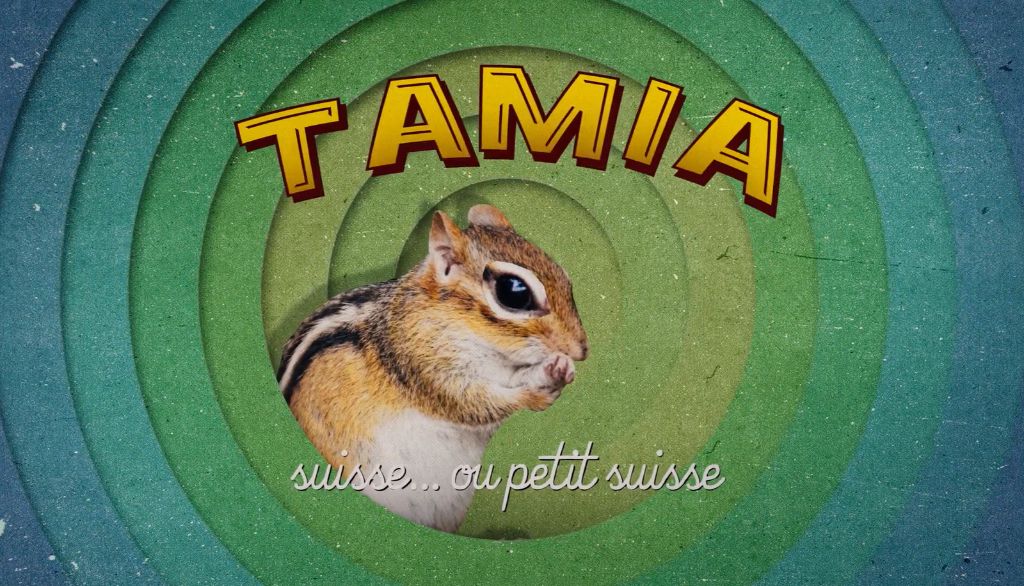
Au fait, pourquoi appelle-t-on les tamias rayés des petits «suisses», alors qu'il n'y en a pas en Suisse? C'est une comparaison avec le costume rayé des mercenaires suisses qui ont servi en France du 15e au 19e siècle, ou avec celui des soldats de la garde suisse pontificale, nous apprend le TLFQ.
Alors, comme le conseille Charles Beauchesne à la fin d'une capsule, «la prochaine fois que quelqu'un vous raconte l'histoire d'un mot, ne vous laissez pas enfirouaper par n'importe quoi»!


























