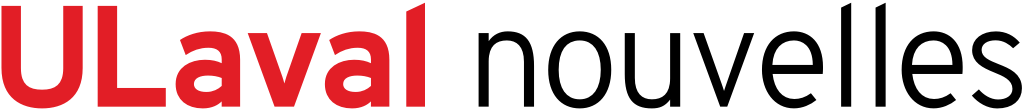— Getty Images
Les images de voyageurs seuls au pied d'un immense glacier ou en communion avec la nature sur une sauvage plage de sable ne montrent rien des longues files d'attente d'amateurs d'Instagram pour accéder à ces sites naturels. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, 1,4 milliard de personnes ont visité un autre pays en 2018, un chiffre qui devrait atteindre 1,8 milliard en 2030. Faut-il s'inquiéter des conséquences de cette explosion de visiteurs sur les sites naturels ou culturels? L'analyse de Pascale Marcotte, professeure au Département de géographie.
À partir de quand parle-t-on de tourisme de masse et pourquoi?
On s'en plaint depuis les années 1970 alors que la quantité de visiteurs, qui se concentraient sur certains sites, a crû de façon importante sur la planète. À l'époque, le manque d'outils technologiques comme le GPS limitait les déplacements des touristes hors des grands centres. En général, les visiteurs restaient donc dans les grandes villes ou les centres touristiques, à des saisons bien précises. Au cours des années 1980, les infrastructures touristiques se sont mises en place afin d'absorber cette clientèle croissante. L'apparition des transporteurs à bas prix, les low cost, puis l'arrivée de nouvelles technologies et des réseaux sociaux ont changé la donne. D'abord, le nombre de voyageurs augmente beaucoup puisque le transport est maintenant moins cher. Ensuite, les touristes se retrouvent dans de nouvelles régions et surtout dans d'autres quartiers de villes très fréquentées. Avec l'arrivée d'Airbnb, les touristes ne restent plus confinés aux hôtels des zones historiques. Les habitants peuvent même les voir de leur cour arrière! Cela donne parfois l'impression que tout à coup ils sont plus nombreux et surtout, beaucoup plus proches.
De quelle façon l'afflux de touristes menace-t-il certains sites historiques ou naturels?
Les experts distinguent maintenant le tourisme de masse du surtourisme. Dans le premier cas, il s'agit essentiellement d'une quantité importante de visiteurs. Souvent, des tours d'appartements ont été construites pour eux le long des côtes, comme en Floride ou dans le sud de la France. Le surtourisme, lui, survient lorsque le nombre trop élevé de touristes nuit à l'expérience de voyage. La pression sur un lieu devient trop forte et les touristes n'y trouvent plus leur compte. Sans parler des résidents qui se sentent envahis dans leur quotidien. À Venise, à Barcelone ou à Paris, il devient de plus en plus difficile de se loger. Certains parcs nationaux, surtout ceux proches des villes, font face aussi à un brusque achalandage de visiteurs, attirés par des images diffusées sur les réseaux sociaux. Certains tentent d'adapter leurs infrastructures, mais le temps leur manque, car ce sont des phénomènes très éphémères. L'afflux de touristes a ainsi dévasté certains paysages islandais à l'écosystème fragile, car tout le monde répétait qu'il s'agissait d'une destination bon marché. Au fond, on a l'impression d'assister à une perte de contrôle de la communication touristique.
Comment expliquer cette tendance des humains à se précipiter vers une même destination?
Beaucoup de personnes qui fréquentent les réseaux sociaux ont envie d'imiter le comportement de gens qui ont l'air heureux et qui se sont pris en photo dans certains lieux. Cela correspond aussi à un besoin de gratification. On a l'impression qu'il faut reproduire certains comportements, très valorisés par un nombre élevé de likes. Dans notre société, l'individu cherche souvent la reconnaissance et il craint qu'une action inédite n'intéresse personne. À ce phénomène quasi «pavlovien», s'ajoute la façon dont nous menons nos recherches d'informations touristiques. Même s'il existe une quantité phénoménale de données disponibles sur la toile, les moteurs de recherche nous guident. Finalement, l'univers se réduit aux trois ou quatre premières entrées sur Google en fonction des algorithmes, et ce, où qu'on soit sur la planète. Je pense qu'à long terme, il va donc peut-être falloir réfléchir aux valeurs qui nous motivent à voyager. Par exemple, est-ce qu'on cherche à avoir une relation de qualité avec les habitants des endroits que nous visitons? L'industrie touristique doit aussi se questionner sur les répercussions qu'elle a sur les ressources publiques, comme l'entretien des routes ou la construction d'usines pour traiter l'eau potable. Le tourisme durable, cela ne se limite donc pas à faire laver ses serviettes aux trois jours plutôt que quotidiennement dans les hôtels.