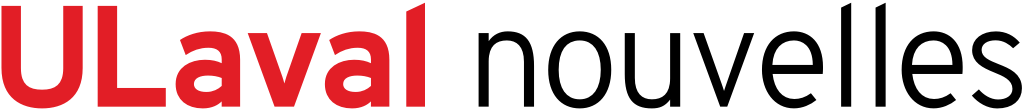Quelles conséquences pourrait avoir l'arrivée de produits agricoles européens sur les producteurs d'ici?
Selon moi, cela n'aura pas un effet très important. Il ne faut pas oublier qu'une partie de notre production – particulièrement le lait, la volaille et les oeufs – dépend du système de la gestion de l'offre au Canada. Pour importer de tels produits, il faut payer des tarifs de douane très élevés. En fait, l'accord avec l'Union européenne touche surtout les importations de fromages. La quantité de fromages qui entre actuellement sans taxe douanière va doubler progressivement d'ici 6 ans. La première année, 2 600 tonnes supplémentaires de fromages européens arriveront sur les marchés canadiens. Cela s'ajoute aux 20 000 tonnes de fromages déjà importées. Il s'agit donc d'une quantité relativement marginale. Elle représente à peine 5% de la production canadienne. Je crois que les fromageries d'ici peuvent faire face à cette concurrence. Ce secteur s'est d'ailleurs affermi ces dernières années avec l'achat de petits et de moyens producteurs par Saputo et Agropur. Par contre, la situation pourrait être plus difficile pour les petits fromagers. Cependant, plusieurs disposent d'un marché de niche en desservant, par exemple, des restaurants ou des épiceries fines.
Qu'est-ce que le Québec pourrait gagner avec cet accord?
Les échanges se mettent en place progressivement. Du côté canadien, cela concerne 90% des tarifs douaniers. Il convient de préciser que 60% des marchandises agricoles expédiées vers les pays de l'Union européenne n'ont actuellement pas de barrières tarifaires. Dans six ans, cet accord va permettre aux producteurs de porc d'exporter annuellement en Europe 75 000 tonnes de porc sans payer de droits de douane. C'est un marché intéressant, mais les destinations les plus importantes pour cette production restent les États-Unis et le Japon. Commercer avec l'Union Européenne permet surtout de pallier un éventuel protectionnisme américain, car il s'agit d'un marché avec un grand nombre de consommateurs aux revenus intéressants, même s'il y a beaucoup de concurrence. L'accord commercial avec l'Europe doit aussi, par exemple, permettre de clarifier des règles différentes en matière de configuration des abattoirs. Il faudra voir si les discussions conduiront à un accord, car les négociateurs européens se sont montrés intransigeants dans certains dossiers agricoles. Je pense, par exemple, à l'interdiction d'exporter là-bas des céréales génétiquement modifiées, comme du canola, ou des boeufs traités avec des hormones de croissance.
Les accords commerciaux entre les pays représentent-ils un danger pour l'agriculture locale?
Lors de la négociation du premier accord de libre-échange avec les États-Unis dans les années 80, certains craignaient qu'il ne provoque la fin de l'industrie vinicole canadienne. Or, même si davantage de vins américains sont disponibles au Canada, cette production n'est pas disparue. À la même époque, une dispute commerciale avec les Américains a obligé les Canadiens à payer des droits compensatoires sur la viande et les animaux vivants exportés aux États-Unis. Il a fallu un certain temps pour régler la question, mais le Canada a fini par gagner dans cette cause. On ne doit pas négliger l'importance des exportations agricoles pour les producteurs québécois et canadiens. Pour s'enrichir, mais aussi pour profiter d'une variété agroalimentaire, le commerce est indispensable. Comme dans d'autres secteurs, la concurrence stimule les entreprises agricoles, qui en profitent pour investir et devenir plus compétitives. Il faut donc avoir de bonnes politiques publiques et le gouvernement doit faire son possible pour limiter les barrières commerciales. C'est généralement le cas des dirigeants canadiens, qui ont toujours été favorables aux agriculteurs.