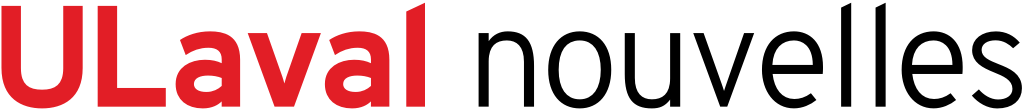Selon la Banque mondiale, la résistance aux antibiotiques pourrait faire diminuer de 3,8% le PIB mondial, soit davantage que la crise financière de 2008. Comment expliquer l'ampleur de ce phénomène?
La Banque mondiale a introduit dans son modèle de prévision de croissance une variable concernant la résistance bactérienne. Selon cette modélisation, la difficulté à vaincre certaines maladies affecte la santé humaine et contribue à une mortalité accrue. On n'a peut-être pas conscience de l'importance de l'utilisation des antibiotiques dans les pays développés, notamment dans les cas de chirurgie. Une opération à coeur ouvert ou de la hanche requiert un traitement par antibiotique pendant quelques jours. En cas de résistance au médicament, le patient risque d'être hospitalisé plusieurs semaines aux soins intensifs, ce qui entraîne des coûts directs très importants sur le système de santé. Sans oublier les coûts indirects sur la productivité au travail de cette personne. La Banque mondiale s'intéresse aussi à la diminution de l'efficacité des antibiotiques sur le secteur agroalimentaire, qui risque de provoquer une baisse de la productivité de l'élevage. Ces différents éléments ont donc des effets indirects sur plusieurs secteurs de l'économie et sur la croissance anticipée.
Pourquoi les pays en développement sont-ils particulièrement touchés par ce phénomène?
L'économie de ces pays dépend beaucoup du secteur primaire, notamment de l'agriculture et des industries exigeant une main d'oeuvre importante. À l'inverse, nos pays développés reposent sur l'économie de services, avec un capital élevé en machines et en ordinateurs. Les machines, elles, ne tombent pas malades. Dans les pays en développement, le processus de production demande davantage de travailleurs. Si la résistance bactérienne affecte les effectifs, cela va donc poser plus de problèmes qu'en Occident. De plus, les systèmes de santé sont moins performants. Ils ne permettent pas toujours d'effectuer des tests pour bien identifier la souche bactérienne lorsque le médicament prescrit ne fonctionne pas. Les malades ont donc moins accès aux antibiotiques appropriés. Tout cela constitue une prise de conscience nouvelle. Jusqu'à présent, les gouvernements et les organismes de santé ont surtout essayé d'éradiquer la prévalence de certaines maladies comme la polio, la tuberculose ou la malaria. Aujourd'hui, on réalise que certains médicaments perdent de leur efficacité.
Quels sont les moyens économiques à déployer pour prévenir cette crise sanitaire?
Depuis plusieurs années, des économistes, comme moi, considèrent la résistance bactérienne comme une ressource naturelle indésirable dans leur modèle de prévision, au même titre qu'on le fait pour la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cela permet d'anticiper l'évolution de la résistance aux médicaments en fonction des données connues sur la consommation d'antibiotiques. Certains suggèrent l'imposition d'une taxe sur les antibiotiques pour en réduire l'utilisation et ainsi, lutter contre la résistance bactérienne. Une solution qui s'avère intéressante dans des pays comme l'Inde ou le Brésil, où le consommateur achète ce médicament sans prescription et le paierait donc plus cher. C'est toutefois moins pertinent dans les pays qui possèdent des systèmes d'assurance-santé, car le patient ne paie pas le plein prix du médicament. D'autre part, il faut, selon moi, prendre conscience de l'importance de la résistance bactérienne croisée entre antibiotiques. Un médicament conçu pour traiter une affection animale peut se révéler très proche d'un produit mis au point pour les humains et produire de la résistance. Il faudrait donc revoir les règles de droit de propriété des brevets. On devrait élargir le spectre d'un brevet pour qu'il englobe une famille d'antibiotiques combattant des maladies différentes et non pas se limiter à un antibiotique spécifique. Il faudrait aussi allonger, dans certains cas, la durée des brevets, pour que le propriétaire de l'antibiotique veille sur l'efficacité de son produit plus longtemps.