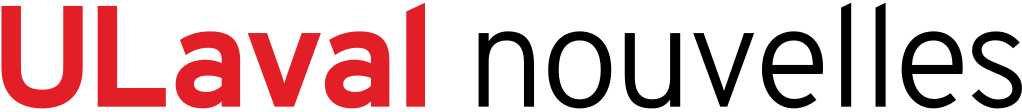|
3 octobre 2002  |
Quatre gars, six filles!
Au début des années 1970, 40 % des étudiants
de premier cycle à l'Université Laval étaient
des femmes. Cette année, elles sont 59 %. En première
année de bac, on parle de 60,4 %. Plus de six sur dix.
Selon les experts, il s'agit là d'une tendance lourde qui
n'est pas près de se démentir.
Pour Pierrette Bouchard, de la Faculté des sciences de
l'éducation, les raisons les plus évidentes pour
expliquer ce nouvel ordre des choses ne sont pas un mystère:
les filles travaillent davantage à l'école, elles
réussissent mieux et elles décrochent moins que
les gars. "Depuis que les filles ont accès au même
système d'éducation que les garçons, elles
ont investi l'université. L'éducation a permis aux
femmes de sortir des rôles traditionnels de sexe, de prendre
leur place dans la société et d'être indépendantes.
Pour elles, les études universitaires représentent
un outil de promotion sociale grâce auquel elles ont accès
au savoir et à l'autonomie."
La professeure Bouchard estime que le débat actuel sur
la réussite scolaire des garçons et des filles souffre
d'abus de généralisation. "Je ne crois à
l'hypothèse du manque de modèles masculins à
l'école primaire, ni à la nécessité
d'adapter la pédagogie pour les garçons, ni au retour
des classes séparées. Les gens extrapolent à
tout un sexe des problèmes qui relèvent peut-être
d'autres facteurs. Nos études montrent que ce sont les
garçons des milieux défavorisés qui réussissent
moins bien à l'école. Dans ces milieux, la culture
dominante n'est pas de réussir sa vie en passant de longues
années sur les bancs d'école. Il est donc très
important de bien cerner le problème avant de proposer
des solutions."
Vague de fond
Son collègue Pierre Bélanger estime, lui, qu'il
y a un grave problème chez les garçons. Ses recherches
montrent que, dans les années 1960, les jeunes hommes aspiraient
à aller à l'université. Ce désir est
allé en augmentant jusqu'au début des années
1980, mais il stagne depuis en deçà de la barre
des 50 %. Les filles ont connu un départ plus lent, mais,
poussées par les grands mouvements féministes, elles
ont dépassé les gars au début des années
1980, et elles maintiennent encore un rythme de croissance. "Aujourd'hui,
à résultats scolaires équivalents, les filles
veulent plus aller à l'université que les garçons.
Même les filles qui sont faibles en classe veulent faire
des études universitaires."
Comment expliquer ce revirement? Dans les années 1960,
les garçons qui voulaient accéder aux études
universitaires supportaient, consciemment ou inconsciemment, un
projet de société nouvelle - égalitaire avec
les anglophones - qui visait à faire entrer le Québec
dans la modernité nord-américaine, avance le chercheur.
À partir des années 1970, la société
québécoise a été portée par
un projet de société égalitaire entre les
sexes. "La présence des filles à l'université
supporte ce projet, même si ce n'est pas quelque chose qui
est perçu au plan individuel. Aujourd'hui, il n'y a pas
de projet d'avenir pour les gars alors que les filles, elles,
sont encore en voie de réaliser leur rêve de société
égalitaire. On parle de réformer l'école
pour encourager la réussite scolaire chez les garçons,
mais ça ne donnera rien, s'il n'y a pas de projet d'avenir
qui les pousse à réussir."
Des impacts sociaux
La forte prévalence féminine parmi les étudiants
universitaires ne signifie pas encore l'équité entre
les sexes, prévient Pierrette Bouchard. "Si on regarde
de façon fine où se retrouvent les filles, on constate
qu'elles se concentrent encore dans les filières traditionnelles
et dans les programmes généraux. Même lorsqu'elles
choisissent des programmes comme médecine ou droit, elles
optent plus souvent qu'autrement pour la médecine familiale
et le droit de la famille, plutôt que pour la cardiologie
ou le droit des affaires. Bref, les filles sont encore sous-représentées
dans les secteurs les plus porteurs. Le résultat est que
la réussite scolaire ne se transforme pas encore en réussite
sociale."
Pour cette raison, la professeure Bouchard n'anticipe pas de féminisation
rapide des professions. "Il reste à démontrer
que ce qui se passe à l'université va se traduire
par une plus grande présence des femmes sur le marché
du travail. Considérant la maternité, la conciliation
travail-famille, la difficile réinsertion sociale des femmes
qui ont quitté le marché du travail pendant quelques
années, les femmes risquent d'être moins présentes
sur le marché du travail qu'aux études universitaires."
De son côté, Simon Langlois, du Département
de sociologie, entrevoit des problèmes importants pour
la société québécoise si on ne parvient
pas à attirer davantage d'hommes vers les études
universitaires. Le premier endroit où ces répercussions
se feront sentir est à l'université! "Si les
gars s'inscrivent en moins grand nombre, le recrutement va être
affecté à la baisse. Ce déficit s'ajoutera
au problème de la dénatalité pour produire
un déficit de recrutement encore plus important",
analyse le sociologue.
Par effet domino, ce problème universitaire risque de se
répercuter sur le marché du travail. "L'économie
du savoir occupe une place grandissante sur le marché de
l'emploi. Si les universités ne forment pas suffisamment
de personnes pour répondre aux besoins de la société,
il y aura des répercussions économiques", prédit-il.
Des impacts humains
Les relations homme-femme risquent aussi d'écoper si
le déséquilibre persiste chez les étudiants
universitaires. "Les couples se forment entre gens de mêmes
origines sociales et de même niveau d'éducation,
signale Simon Langlois. C'est ce qu'on appelle la congruence des
statuts entre conjoints. Dans un ménage, la non-congruence
peut entraîner des problèmes de conciliation d'intérêts
et de modes de vie et, éventuellement, constituer une cause
de divorce. Considérant le déséquilibre actuel
dans les inscriptions à l'université, les diplômées
universitaires risquent d'avoir plus de difficultés à
trouver un conjoint avec qui elles pourront avoir une relation
intéressante dans l'avenir." Simon Langlois estime
même que le phénomène pourrait avoir des impacts
démographiques. En effet, au problème de non-congruence
des statuts s'ajoute le fait que les femmes plus scolarisées
ont moins d'enfants. "On peut prévoir que la fécondité
ne remontera pas."
Finalement, avance le sociologue, si les diplômées
universitaires obtiennent une part grandissante des postes professionnels
dans la société, le rôle traditionnel de pourvoyeur
qui incombait à l'homme sera remis en question. "Ceci
pourrait avoir des répercussions importantes parce que
l'homme a longtemps été socialisé comme principal
pourvoyeur de la famille, souligne-t-il. Encore aujourd'hui, les
hommes consacrent plus d'heures que les femmes à leur travail,
même lorsqu'ils sont dans la même profession. Si la
femme devient le principal pourvoyeur, il pourrait y avoir des
conséquences sur la vie des couples et sur le bien-être
des hommes eux-mêmes. Par exemple, la transformation rapide
du rôle traditionnel de l'homme n'est pas étrangère
au taux élevé de suicide chez les Amérindiens."
Succès sans sexe
Marcel Monette, psychologue et vice-doyen à la Faculté
des sciences de l'éducation, abonde dans le même
sens. "Je crois que beaucoup d'hommes ne sont pas prêts
à accepter que la femme soit la principale pourvoyeure
du ménage." Dans une telle situation, il y a quatre
scénarios possibles, avance-t-il. "L'homme qui n'accepte
pas son nouveau rôle pourra sombrer dans la dépression,
éprouver une frustration qui peut conduire à la
violence ou encore mettre un terme à la relation. L'autre
solution est de s'adapter. C'est possible de changer, mais cette
importante transformation est très déstabilisante."
Selon le professeur Monette, il faudrait préparer les hommes
aux changements qui s'annoncent en redéfinissant les rôles
masculins et féminins. "Il faudrait que l'homme apprenne
à se définir autrement que par son rôle de
pourvoyeur dans le couple, qu'il puisse contribuer différemment
à assumer son rôle d'homme, en insistant davantage
sur ses rôles de compagnon et de père."
Il n'y a pas de solutions simples pour réduire l'écart
de réussite scolaire qui se creuse entre les garçons
et les filles, mais "il faut s'attaquer aux causes de ce
problème sans tarder, pour ne pas reproduire aujourd'hui
les injustices dont ont été victimes les filles
dans le passé", affirme Simon Langlois. "Il y
a un problème, mais il ne faut pas faire de guerre de sexes
avec ça, ajoute Pierrette Bouchard. Ce qu'il faut viser,
c'est la réussite scolaire de tous les enfants."
JEAN HAMANN
|
|