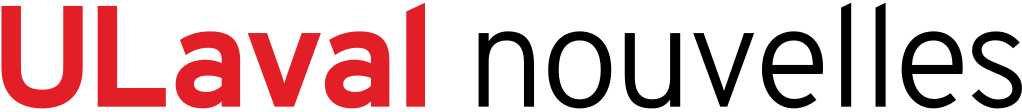|
1 novembre 2001  |
Images de réalité/images de cinéma
Susan Sontag écrivait dans le New Yorker, au
lendemain de l'attaque contre le World Trade Center: "L'Amérique
n'a jamais semblé être plus éloignée
de la reconnaissance de la réalité qu'en face de
la monstrueuse dose de réalité du mardi 11 septembre".
L'écrivaine américaine et new-yorkaise déplorait
"la campagne" des leaders et des médias américains
"destinée à infantiliser le public".
Elle s'indignait devant "le fossé qui sépare
ce qui s'est passé et ce qu'on doit en comprendre, d'une
part, et la véritable duperie et les radotages satisfaits
colportés par quasiment tous les personnages de la vie
publique et les commentateurs de télévision, d'autre
part". Et elle terminait sa phrase par ces mots: "Cette
séparation est stupéfiante et déprimante."
Dans les années quarante et cinquante, devant le réalisme
triomphant des techniques hollywoodiennes, on se disait: le cinéma
est en train de refléter la réalité. Deux
décennies plus tard, en constatant qu'Hollywood ne cessait
de frapper ses images au coin de l'hyperréalisme exacerbé,
on a senti que les données s'inversaient: "Ce qui
est désormais à prévoir, écrivait
Dominique Noguez (Le Cinéma autrement, 1977, p.
93), c'est que la réalité se mette de plus en plus
à ressembler au cinéma."
C'est ce qui s'est passé, malheureusement et tragiquement,
le 11 septembre et les jours qui ont suivi. Et c'est ce qui explique
la stupéfaction de Susan Sontag. Ce réel-là
qui cache sous son horreur une complexité immense nous
a été donné dans des séquences d'images
de premier niveau visible, simplistes et manichéennes,
à la ressemblance des films catastrophe (on n'a qu'à
revoir The Day after, Fight Club, Mars Attacks
et, surtout, Independance Day ).
Le piège des "reaction shots"
On nous a donné quatre séquences d'images pour
rencontrer notre réalité cinématographique:
l'attaque sur les tours jumelles et sur le Pentagone (donnée
et redonnée à voir à répétition,
sur tous les angles et selon tous les plans, le gros, le rapproché,
le moyen, le général, il faut revoir les images
de la destruction de New York, dans Independance Day);
les réactions ("reaction shots") qui ont suivi
se sont déroulées en une chaîne ininterrompue
d'émotions qui a rempli nos écrans pendant des jours
et des jours et qui ne se cassait, momentanément et par
flashs, que pour pointer du doigt le vilain, l'islamiste fou sortant
de sa caverne (une amorce du montage parallèle qui va s'installer
entre les bons et les méchants); le discours de Bush à
la nation entrecoupé de vingt-trois images (on les a comptées
pour nous) de réactions en ovations debout entérinant
la guerre de la "justice infinie" contre l'absolue barbarie
(le discours du président américain, dans Independance
Day, qui va lancer les bons Américains contre les
méchants extraterrestres a eu droit, lui, à une
bonne trentaine d'images réactionnelles de faire-valoir,
la réalité n'a pas encore tout-à-fait rejoint
le cinéma); enfin, des plans d'ensemble de militaires
en formation de marche montés avec des gros plans d'avions
et d'unités navales, cependant que nous est montrée,
en montage parallèle, la cible, le pays asiatique, sombre,
misérable et pagailleux, qui abrite le vilain.
Dans la gueule de Disney
Récemment , Marie-France Bazzo, dans son émission
Indicatif présent, recevait un invité qui
lui disait que pour se libérer des images de New York
il avait décidé de regarder un bon vieux film de
Disney. Le pauvre, il ne se rend pas compte qu'il a sauté
en plein dans la gueule du loup. Si les images de cinéma
contaminent à ce point les images de notre réalité,
Disney en est, pour une grande part, responsable. Les techniques
de base et les mythes fondateurs de la nation américaine
qui animent, depuis plus de soixante ans, les produits d'animation
Disney (Blanche Neige -1937 et Tarzan - 1999 ,
c'est du pareil au même) sont des calques à la main
des tactiques hollywoodiennes depuis D.W. Griffith jusqu'à
Frank Capra, en passant par les maîtres du western. En
somme, une stratégie de manipulation du spectateur en
deux étapes, trois, si l'on veut filer le processus jusqu'à
nos jours: les grands cinéastes populistes mettent en
place et en scène les techniques de base du dressage de
l'oeil productrices à notre insu, des mythes américains
(le couple civilisation/sauvagerie, la bénédiction
divine, l'égalité des chances, notamment); Disney
les reprend et nous les refile, photogramme par photogramme; les
Hollywoodiens actuels, Spielberg et compagnie, forts de l'imprégnation
desdites techniques dans notre matière grise depuis l'enfance,
les chevauchent au galop dans une explosion de couleurs et d'effets
spéciaux visuels et sonores.
Bonté blanche, vilénie noire
Le chaînon Disney de transmission de l'hollywoodisme
est d'une importance cardinale dans le processus de fascination
du spectateur et, peut-être bien, dans notre difficulté
à reconnaître la réalité dans sa complexité,
comme le déplorait Susan Sontag. Le dessin animé
est du pur cinéma, du cinéma pur, si l'on peut dire.
Ses personnages dessinés à la main et dont le plus
infime mouvement est maîtrisé n'existent que sur
la pellicule, au moment de la projection. Au contraire des vedettes
en chair et en os qui jouent au golf cependant que leur personnage
fantômatique vit sur l'écran, le dessin animé
cesse de vivre dès que le projecteur s'éteint.
Comme Pinocchio qui ne s'anime que sous la baguette de la fée.
Rien de plus pur, par conséquent, de plus contrôlé,
de plus schématique, de plus définitivement "monté"
dans la linéarité du mouvement, en un mot, rien
de plus hollywoodien qu'un dessin animé à la sauce
Disney. C'est là que miroite, dans sa splendeur virginale
et emblématique et sous le couvert de l'innocence enfantine,
le duel en champ/contrechamp, en images d'action/réaction
et en montage parallèle manichéen, entre la bonté
blanche et la vilénie noire.
Si nous sommes tombés si facilement dans le piège
des manipulateurs des images new-yorkaises, c'est, dans une large
mesure, que nous nous sommes abreuvés, alors que nous ne
marchions pas encore sur nos jambes, avant même que nous
puissions aller tout seul au cinéma des grands, aux structures
duelles et primaires des produits d'animation Disney: la nuit/le
jour, l'ombre/la lumière, la laideur/la beauté,
la grimace/le sourire, le noir/le blanc, la haîne/l'amour;
en somme, la sauvagerie et la civilisation, qui est l'un des
mythes les plus déterminants de l'histoire américaine
(dixit le célèbre historien F.J. Turner).
Si l'on y réfléchit bien, ce n'est rien d'autre
que l'attelage binaire du champ/contrechamp qui fait fonctionner
le système-cinéma installé dans le double
parfait salle obscure/écran lumineux.
Il y a autre chose. Si nous avons été rivés
si longtemps aux images de premier niveau visible de nos téléviseurs,
c'est que nous avons été contaminés, des
centaines de millions de fois (quatre millions de dessins pour
le seul Blanche Neige ), par les lieux communs des lois
naturelles qui régissent l'univers Disney: Le corps lourd
descend à la verticale, le feu brûle, l'eau mouille,
la glace est glissante, la nuit est noire, la jour est clair,
les oiseaux chantent, les postérieurs sont ronds et les
queues frétillent, les yeux regardent et les nez ronflent,
la timidité fait rougir et l'amour fait battre les cils,
les lapins sont gentils et les crocodiles méchants, les
lions aux crinières blondes sont courageux et les hyènes
noires du désert sont lâches, le chat ronronne et
le canard fait coin-coin....
Edgar Morin a tenté de nous faire comprendre que "Pour
sortir du 20e siècle", il nous faudra accéder
à la complexité, c'est-à-dire à la
capacité de saisir l'invisible sous le visible. Il apparaît
que nous n'avions pas ce qu'il fallait pour comprendre. C'est
pour cela que notre sortie s'est faite tout croche.
PAUL WARREN
Professeur retraité de la Faculté des lettres
|
|