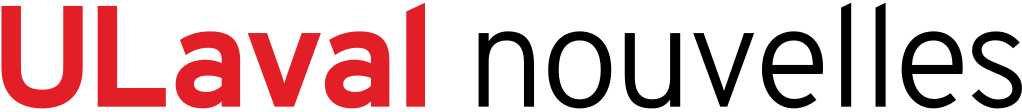|
2 décembre 1999  |
LE COURRIER
À PROPOS DE L'OUVRAGE COLLECTIF MAIN BASSE SUR
L'EDUCATION
Monsieur le rédacteur en chef, vous avez publié
récemment un article assez gros sorti de la plume commune
de deux professionnels de l'éducation. Cet article s'attaque
avec beaucoup de muscle à un ouvrage collectif que j'ai
dirigé, plus précisément à l'article
que j'y ai signé, de même qu'à ma personne.
Je crois comprendre que mes collègues Mellouki et Gauthier
ont le sentiment d'avoir été les victimes d'une
grave injustice et qu'ils ont conclu que ce sentiment leur donnait
des droits exceptionnels. Venant d'une zone du "savoir-être"
voué à fabriquer la "personnalité intégrale"
de nos enfants, sans doute est-il normal que ce texte de rééducation
place ma personnalité intégrale (plutôt que
mon argumentation) au foyer de son attention, quitte à
l'inventer en cours de route pour les besoins du châtiment
exemplaire qu'il expose à vos lecteurs.
Comme je n'ai pas l'honneur de connaître les sus-nommés, je ne me sens pas autorisé à retourner l'hommage paramilitaire qu'ils rendent à mes lacunes personnelles et à mes intentions secrètes. Ils nous disent en terminant leur texte qu'il y aurait beaucoup moins de professeurs au Québec s'il n'y avait pas eu de modernisation scolaire et qu'il y aurait au moins un avantage à cela: il y aurait ainsi "moins de gueulards mal intentionnés pour qui penser signifie vomir ses préjugés". Notre institution se piquant de compter ces professionnels de l'éducation au rang de ses professeurs, leur sentence finale me semble inspirée par le mépris de soi et je ne crois pas que nous puissions aller bien loin de cette direction. Dans l'autre sens, je ne suis pas sûr que vos lecteurs accorderaient la moindre importance (et à juste titre) à l'effort que je ferais pour me défendre, avec quelque précision, contre les positions absurdes que l'on m'impute. Je vais donc essayer plutôt dans ce qui suit de présenter clairement quelques-uns des éléments du différend auquel les invectives de nos collègues font écho.
1) Une défense de l'enseignement. L'ouvrage collectif qui sert de prétexte au cri du coeur que vous avez publié est une défense de l'enseignement et de l'École au sens large. Cela n'est sans doute pas évident à la lecture d'Amnésie volontaire. Les neuf auteurs qui sont rassemblés dans cet ouvrage procèdent à la critique des orientations actuelles de différents aspects de notre système scolaire et ils (et elles) le font dans des perspectives complémentaires et convergentes. Comme tout recueil d'articles, l'ouvrage n'est ni complet, ni systématique mais il est cohérent en ceci que les différentes contributions y servent d'illustration les unes aux autres. Cette unité tire origine, me semble-t-il, d'une approche commune de l'enseignement compris comme rapport social encadré par des institutions publiques et fondé sur l'autorité du savoir. Les enseignants, de tout niveau, y sont compris comme artisans des arts (et métiers), des sciences et des lettres, et il est supposé que leur liberté est garantie par les institutions académiques et scientifiques du libre examen et de la critique. Personne n'est obligé d'être en accord avec cette conception, de toute évidence "idéale". Mieux: puisque cette conception garde quelque souvenir de l'utopie moderne d'une autonomie de l'École (une utopie jamais vraiment réalisée mais portée jusqu'à nous par la pratique) et qu'elle y réfère pour juger les transformations qu'impliquent les perpétuelles adaptations de détail de l'École à la société, elle pourra être taxée de "nostalgique" sur examen sommaire et l'on pourra ainsi se convaincre sans effort d'en avoir mis à jour le défaut essentiel en lui criant son nom. On pourra même lui opposer une conception "réaliste" et soutenir plutôt, comme l'a fait pendant longtemps une doctrine qui passait pour science dans les facultés d'éducation et à la CEQ, que l'École n'est en réalité que l'imposition de l'arbitraire culturel d'une classe dominante. L'enjeu étant ainsi posé comme un fait accompli, on soutiendra alors qu'il ne reste qu'à détruire la "tour d'ivoire" et à y faire entrer, avec la lutte des classes, les multiples vérités de classe (puis de genre). Et quel sera le résultat imprévu de cette lutte des classes pour l'appropriation des classes et des esprits? Coke, un des grands maîtres de cet art, fera valoir son droit ($) de diffuser sa culture à l'université pour faire contrepoids aux néo-marxistes qui trônent au Conseil supérieur de l'éducation et il pavera la voie à l'entrée de l'Association des hommes d'affaires à l'école primaire (Association venue là pour offrir aux élèves un muffin épisodique en échange de la reconnaissance des "masses", comme le disent mes critiques, et d'une baisse d'impôt).
2) La Révolution tranquille n'est pas en jeu. La critique des orientations actuelles du système scolaire à laquelle se livrent les auteurs incriminés avec moi repose évidemment sur un "point de vue": celui de l'assomption réfléchie d'un héritage (ce qui inclut notre réforme scolaire des années soixante) et de la résistance à des adaptations qui n'ont plus de projet. Soutenir, comme nous le faisons, que notre système répète comme une névrose des tendances qui s'y sont enracinées dans la rupture qu'à exigée cette réforme ne revient pas à faire l'apologie du régime antérieur ni à déplorer le fait que cette réforme ait eut lieu. Me renvoyer à Chaput, aux Jésuites et aux "chrétiens" (!) qui avaient fait "main basse" sur l'éducation est absurde: "Ou bien nous, ou bien eux!". On risque ainsi de faire l'impasse sur la critique de nos orientations actuelles. D'ailleurs, à quoi nous servira-t-il de reformuler jusqu'à la fin des temps l'alternative de "l'étau de la chrétienté" et de la "modernisation" alors que cela ne fera plus jamais partie de nos choix? Faut-il faire taire les Russes qui critiquent la Mafia en prouvant qu'ils choisissent ainsi le retour du Goulag? Pourquoi l'effort de comprendre la nature de la Révolution tranquille reviendrait-il à se prononcer en faveur d'un temps où il n'y avait que 1% des jeunes à l'université? Faux dilemme qui oppose deux caricatures destinées à faire taire et qui embrouille les tâches du présent dans la répétition lancinante d'un discours de légitimité (la Révolution tranquille!) qui sert de couverture à des pratiques qui n'ont plus aucun lien avec son contenu historique ou avec son orientation initiale. Et depuis belle lurette! Pour tout dire, j'admire presque cette infatigable répétition de la même contradiction: "Nous avions jadis une école horrible, toute entière placée dans la main de fer du clergé et de "l'index", une école dont est pourtant sortie en 1960 une génération lumière qui a tout réinventé sur la seule base de la saine gestion de ses opérations mentales".
Vous et moi, cher rédacteur du Fil des événements, pouvons donc trembler tout notre saoul, comme nous y invitent d'ailleurs vos collaborateurs: sans la sainte modernisation, nous serions sans emploi. Toute critique de ses résultats est "amnésie volontaire" et nous ramènera certainement à la "servitude volontaire" (on a des lettres!) qui était celle de nos parents.
3) Les limites de l'ouverture de l'École. Quant à l'article qui m'a valu la remontrance intégrale de nos collègues Mellouki et Gauthier, il n'est ni très compliqué, ni très original. Il soutient a) qu'une trop grande ouverture de l'École la livre sans défense à la compétition des groupes, b) que la poursuite des trop nombreux objectifs que lui imposent les idéologies du jour mène au remplacement du savoir par une combinatoire de recettes basées sur la régulation du comportement et vouées à la soumission directe des étudiants aux tout puissants "besoins" de la société de marché et, c) que ces évolutions tendent à la décomposition des institutions pédagogiques centrées sur la transmission des savoirs propres à la civilisation qui nous porte de même qu'à la subordination des maîtres aux multiples catégories d'opérateurs "professionnels" du système scolaire (quitte, pour cela, à faire des maîtres eux-mêmes de souples rouages de l'organisation en leur donnant une "identité" plutôt qu'un savoir). Cette perspective générale, je l'ai dit, n'est ni particulièrement nouvelle, comme on s'en convaincra en lisant les écrits déjà anciens de Christopher Lash sur la question, ni exclusivement québécoise, comme on le verra dans l'ouvrage tout récent de Jean-Pierre Le Goff portant sur le cas français. Quant aux nombreux auteurs québécois qui m'ont précédé dans cette voie "diabolique", auteurs dont les meilleurs venaient parfois des facultés d'éducation, il faut le dire, je me dispenserai de les nommer ici pour ne pas attirer vers eux la vindicte de nos collègues.
4) Qui trop embrasse mal étreint. Je refuse de croire, on m'en excusera, que la prétention de former directement des "professionnels" polyvalents de l'enseignement est indépendante de la disposition à charger l'école de n'importe quelle tâche, au fil des modes. Quand on invite la petite école, au nom de la personnalité intégrale de l'enfant, à s'occuper de tout, on multiplie les groupuscules qui voudront y implanter leurs manies "professionnelles": les compétences du "consommateur averti", la connaissance du marché du travail, l'ouverture à la vie sexuelle et amoureuse, l'initiation à l'économie familiale, la formation à la citoyenneté, la découverte de l'Autre, l'ouverture à la mondialisation, la sensibilisation aux toxicomanies, le développement de la confiance en soi et, last but not least, la rééducation des identités sexuelles. Qui lancera sur la pizza de l'école la prochaine tranche de saucisse et qui ajoutera à la grande équipe du système la prochaine catégorie "d'intervenants"? Et cela n'est encore que le début de l'affaire. Même les tâches les plus conventionnelles des enseignants ont été décomposées en une pléthore de modules, d'objectifs, de compétences, d'habiletés, de savoir-faire et de savoir-être où une chatte ne retrouverait pas ses petits mais où la science a trouvé les variables de ce "savoir agir en classe" qui est au fondement du contrôle des enseignants par la technostructure. La récente affaire de la "réussite des gars et des filles" illustre assez cet effort de transformer l'école en un système d'adaptation thérapeutique commandé par des maladies; au fil d'une dizaine de "faire en sorte", on s'apprête à imposer aux maîtres des "opérations pédagogiques" qui désexualiseraient la prochaine génération, mais sans que nous ayons besoin pour cela de transformer d'abord les "hommes et les femmes" en androïdes unisexes. Bref, réglons nos problèmes sur le dos des enfants!
Il est assez clair que les enseignants réels, dont il faudrait honorer ici le grand mérite, n'exécutent pas la moitié des "opérations" que le système met au programme et que c'est cette part de désobéissance fondée sur le bon sens et sur le savoir disciplinaire qui fait encore marcher l'école. Notre ouvrage se contente de saluer cette résistance des artisans qui sont personnellement impliqués dans la transmission du savoir et d'attirer l'attention sur ce qui vise à lui retirer ses moyens.
5) La préparation au marché ne peut pas tout envahir. Pourquoi ceux (dont je suis) qui soutiennent que l'école secondaire devrait s'en tenir aux arts, aux science et aux lettres qui forment le fonds de "culture seconde" de nos sociétés se font-ils accuser de mépriser le "marché" ou la "société"? N'avons nous pas des centaines de programmes, au collégial et à l'université, dont c'est la fonction de se soucier des formations professionnelles? Sommes-nous devenus si pauvres que la démocratisation de l'école doive être une course visant l'adaptation des "masses" aux exigences de Mac-World? Parlant des formations professionnelles, pourquoi faudrait-il faire confiance à la frénésie combinatoire qui engendre des programmes just in time qui courent après l'avenir quand les hôpitaux réussissent à manquer d'infirmières? Quel grand danger nous menacerait-il si nous devions cesser de patauger derrière les nouveaux défis de nos lubies pour consolider plutôt ce qui a encore du sens?
Je crois que nous nous serons approchés de la réponse à ces questions quand nous aurons compris pourquoi la formation secondaire "classique" dont sont sortis tous nos ministres de l'éducation et la majorité de nos universitaires est devenue une horreur "chrétienne" le jour où il a été question de l'améliorer et de l'étendre à tous. Nous n'avions pas les moyens d'une démocratisation de ce type, me dira-t-on? Voilà qui expliquerait au moins que nous ayons une école publique où bon nombre d'entre nous, même dans les facultés d'éducation, n'osent pas laisser leurs enfants.
6) Qui mettra la main sur l'Université? Les choses ne sont évidemment guère très différentes à l'Université. Les coupures budgétaires et les nouvelles définitions de la concurrence qu'elles imposent nous obligent à tant d'ouverture et de flexibilité qu'il n'y aura bientôt plus rien à liquider. Les organismes subventionnaires, priorités stratégiques en tête, mènent le bal et exigent de la recherche universitaire qu'elle se mette à la remorque de ses inévitables "partenaires" en vue de leur transférer à court terme des résultats exploitables. Mieux: on invitera les professeurs à créer des entreprises qui pourraient engager leurs étudiants et on leur offrira des tarifs très raisonnables pour l'usage des laboratoires. Les "besoins" de la société, portés par dix mille voix discordantes auxquelles vient de s'ajouter celle du nouveau président du CRSH, nous font courir comme des fous dans toutes les directions à la fois et nous gaspillons nos meilleurs efforts et une part croissante de nos "ressources" à explorer des voies sans issues. La bataille des clientèles nous lance, sans compter à la dépense, aux trousses des étudiants virtuels de demain et nous négligeons ceux qui prennent l'autobus pour venir sur le campus donner à leur vie une orientation décisive et permanente. Nos fantasmes tournent de plus en plus autour du peuple imaginaire de "l'économie planétaire du savoir" et de la "formation continue" pendant que nous consacrons une part importante de l'argent de nos étudiants réels à arracher des "clients" aux autres universités du Québec. L'économie étant maintenant une économie du savoir, dit-on, nous résistons mal à la dissolution de l'université dans cette économie et nous risquons de devenir une gigantesque subvention cachée pour des entreprises dont c'est le moindre des soucis que de favoriser l'autonomie professionnelle, scientifique et culturelle de nos diplômés. A cause des longueurs que nous imposons à la formation du "personnel" de demain quand nous tenons à cette autonomie (comme c'est le cas avec les maîtres et les docteurs, par exemple) et à cause de notre insistance résiduelle à mener des recherches libres ou fondamentales, nous coûterons toujours trop cher au goût de ceux qui utilisent gratuitement les services d'une institution que les payeurs de taxes et les étudiants sont les seuls à supporter. Le système scolaire québécois serait-il le moins dispendieux de toute l'Amérique du nord, cela ne fera que le soumettre d'avantage aux contraintes d'un "refinancement" qui lui sera compté sur la base de sa soumission aux multiples puissances, idéologiques et économiques, qui visent à s'en rendre maître.
7) La nostalgie. Évoquer (même s'il est toujours déjoué) l'idéal d'autonomie du savoir et son ancrage dans les arts, les lettres et les sciences où une civilisation débat avec elle-même ainsi qu'avec le monde qu'elle produit relève peut-être de la nostalgie, mais seulement au sens où la nostalgie fait elle-même partie de la connaissance de la société. Car c'est mieux nous connaître nous-mêmes que de faire l'effort de redécouvrir le sens d'un idéal que nous avons abandonné; alors que nous sommes encore incapable d'en imaginer un nouveau et de résister, sur une base nouvelle, aux puissances qui profitent du vide, c'est prudence que de défendre les institutions que cet idéal à laissé derrière lui et, pour cela, de les comprendre à sa lumière. En me traitant de nostalgique, mes collègues ont vu quelque chose, mais sans essayer de comprendre ce qu'ils voyaient; ils ont donc, cher rédacteur en chef, gaspillé leurs émotions à vouloir ainsi m'insulter.