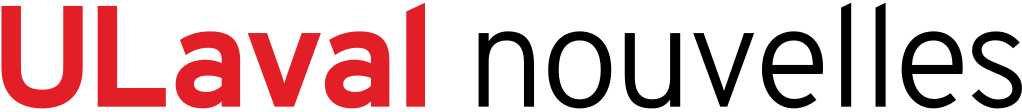|
9 octobre 1997  |
IDÉES
Une université victime du clientélisme?
PAR DENYS DELÂGE
DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE
"La logique du clientélisme, et celle, comptable, du financement par points d'activité, ont eu pour effet la multiplication des programmes, non plus pour la formation mais pour la satisfaction des clientèles."
"Les étudiants-clients qui croient que les frais de scolarité et le temps passé en classe constituent le prix d'achat de leur formation et qui s'imaginent qu'il n'y aura pas de travail académique à faire sont mieux de quitter. "
Les étudiants seraient, au dire de plusieurs, notre clientèle pour lesquels il faudrait multiplier les produits éducatifs en nombre, en variétés, en valeurs et auxquels il faudrait demander par questionnaire d'évaluer le service de vente et d'après vente pour ajuster notre marketing. Au lieu de voir l'enseignement comme notre marchandise, nous pourrions, d'un point de vue analogue considérer que l'université produit une marchandise - les étudiants - et demander à nos acheteurs - les employeurs - comment ils évaluent ce qu'ils achètent. Nous aboutissons à l'université des sondages où les programmes se multiplient, se diversifient en fonction des clientèles. L'université cesse d'être une institution qui définit le savoir et la manière de le transmettre.
La maladie a atteint déjà profondément les Facultés molles de lettres et de sciences sociales, beaucoup moins celles de sciences, bien qu'encore... Tout de même ce ne sont pas les industriels et les contracteurs qui disent aux professeurs de génie comment faire. Je ne prétends évidemment pas que les étudiants et les employeurs n'ont rien à dire sur l'enseignement universitaire, je crois même que leurs avis sont indispensables. Cependant je pense que l'université ne doit être d'abord ni un commerce, ni une industrie, ni un centre d'achat. L'université c'est la rencontre de professeurs et d'étudiants pour la transmission du savoir. S'il fallait recourir à une métaphore, j'utiliserais celle des maîtres et des artisans. Nous devons apprendre un métier intellectuel et professionnel à des jeunes qui viennent acquérir une discipline, des habiletés fondamentales, une distance critique, des savoirs-faire. Il importe pour cela que l'enseignement comporte un contenu, qu'il soit exigeant, qu'il pose des défis, qu'il soit ouvert, qu'il soit centré sur une discipline, quelle qu'elle soit.
L'exigence de la progression
Cela doit être défini de l'intérieur d'abord, par les
professeurs, bien sûr en interaction avec le milieu. Les programmes
doivent être encadrants et comporter une progression d'année
en année. Un programme complètement "interdisciplinaire"
du type du baccalauréat général ne vaut rien parce
qu'il n'y a ni formation de base ni progression. L'étudiant papillonne
de cours introductifs en cours introductifs, aussi excellents soient-ils.
Il faut qu'il y ait une discipline - colonne vertébrale, à
partir de laquelle greffer les savoirs. C'est aussi à partir de cette
discipline que l'étudiant doit apprendre à écrire,
à s'exprimer oralement, à acquérir l'autonomie, les
habiletés pratiques. Tout ce que l'on fait pour séparer ces
apprentissages de la formation disciplinaire constitue, à mon avis,
une fausse piste. Il n'y a pas non plus de formation sans appartenance :
il faut des communautés de professeurs qui ont eux-mêmes le
sentiment de travailler pour les étudiants et qui jouent le rôle
de "mentors".
Une université de professeurs absents ou qui ne font pas leur métier d'intellectuels enseignants-chercheurs-écrivains n'en est pas une. Il en va de même pour une université où les étudiants ne se connaissent pas. Les étudiants doivent avoir le sentiment de progresser avec des pairs, de grandir entre la première et la troisième année du baccalauréat, ils doivent vouloir relever, avec d'autres, un défi difficile et être capables de se reconnaître entre eux, de distinguer et d'admirer leurs aînés, de servir de modèles aux plus jeunes. Pour cela ils doivent se connaître.
Cela n'implique pas qu'il ne faille rien changer aux programmes départementaux. Nous pourrions envisager que certaines formations disciplinaires sont trop étroites ou qu'il faille les juxtaposer à des formations disciplinaires plus larges. Ainsi on pourrait imaginer un baccalauréat en sciences humaines ou encore un baccalauréat en sciences sociales. Cela, à mon avis, est tout à fait recevable, voir souhaitable à la condition qu'on respecte les principes dont je viens de faire l'exposé: cela veut dire que serait exclue une formation "lâche" où les étudiants reproduiraient en sciences sociales ou en sciences humaines les règles du baccalauréat général, c'est-à-dire à chacun son menu, pas de programme, pas de progression, pas de cohortes, pas d'appartenance.
Direction propédeutique?
On pourrait également envisager une autre hypothèse consistant
à créer une première année propédeutique
facultaire avant de s'engager dans une discipline en deuxième année
du baccalauréat. Mes collègues cinquantenaires et moi-même
avons souvent connu ce curriculum et en gardons généralement
un excellent souvenir. En sciences sociales cela consisterait à suivre,
dans de grands amphithéâtres, des cours d'introduction à
nos disciplines : économie, anthropologie, sciences politiques, démographie,
sociologie, etc. Les avantages sont certains pour l'interdisciplinarité,
pour l'ouverture, pour l'économie de ressources professorales. Cela
exige un excellent encadrement avec des étudiants avancés
- auxiliaires d'enseignement. Les désavantages concernent évidemment
l'anonymat et l'impossible émergence de sentiments d'appartenance
en première année.
Au plan des ressources professorales, quelles que soient les décisions concernant les programmes (statu-quo, propédeutique de sciences sociales, baccalauréat en sciences sociales), il est certain que nous pourrions faire davantage pour mettre en commun. Plusieurs départements donnent des cours analogues qu'il ne serait pas nécessaire de dédoubler. Cela ne serait possible qu'à la condition cependant que nous cessions de multiplier les programmes sur-spécialisés.
La logique du clientélisme à l'université, et celle, comptable, du financement par points d'activité ont eu pour effet la multiplication des programmes, non plus pour la formation mais pour la satisfaction des clientèles. Cela conduit à rendre apparemment "obsolètes" les formations fondamentales. Pourquoi faire un diplôme de service social si on peut se débrouiller avec gérontologie ? Pourquoi faire sciences politiques alors que communication publique et journalisme sont des formations calquées sur des carrières ? Voilà donc que l'on offre, en lettres seulement, 57 programmes d'études au 1er cycle, 27 aux 2e et 3e cycles. Puisque beaucoup de ces programmes à la pièce n'offrent pas de formation solide, on veut les améliorer en les "inter-disciplinant" : résultat, on en réduira encore le noyau. Prenons l'exemple de la formation au baccalauréat spécialisé en histoire. C'est un programme exigeant, structuré et encadrant: peu de cours optionnels, une progression sur trois ans, des cours de méthodes, des exigences d'écriture. Plus de quatre cents étudiants s'y étant inscrits aux divers niveaux à l'automne 1996, se pose évidemment la question de l'employabilité. Aucun diplôme d'histoire ne conduit à l'enseignement au secondaire, il faut deux ans de pédagogie. Le gouvernement n'embauche plus. Où vont travailler ces étudiants? Tourisme, musées, recherche? Que faire? Réponse: idéalement, rendre la formation en histoire davantage polyvalente pour que les finissants se placent mieux sur le marché du travail. Ne va-t-il pas de soi qu'un historien ait de l'autonomie (cours de gestion du temps) de l'entregent (cours de relations humaines), une facilité d'écriture (cours de ?), avec évidemment des connaissances en démographie, en géographie, etc.
Certes tout cela est indispensable, mais c'est à partir et dans la discipline qu'il faut l'acquérir. Une formation n'est pas qu'une juxtaposition de cours magistraux avec un examen et un travail long. Cela comporte des cours théoriques, des cours d'objets, des cours de méthode, des cours pratiques. Cela implique une progression et une articulation. C'est cela que nous sommes en train de démolir. "Back to Basic", il faut refuser cette logique.
C'est Larose qui a raison
Alors les étudiants d'histoire ne se trouveraient pas de travail
(ce qui est vrai) parce qu'ils ne sont pas assez polyvalents? Parce que
leur formation est trop disciplinaire? Solution: défaire la discipline.
J'apporterais plutôt la réponse suivante :
1o Les étudiants d'histoire n'ont pas de travail parce que, jusqu'à tout récemment, nous avons fait le choix de société de ne pas enseigner le passé aux jeunes ( il en va de même avec la géographie pour le rapport à l'espace. Nous avons privilégié les cours "choix de carrière", "travail domestique", etc. Nous avons voulu que l'école "règle les problèmes sociaux". Nous revenons heureusement à la formation de base au primaire et au secondaire.
2o Les étudiants d'histoire n'ont pas de travail parce qu'il ne faut plus être historien pour enseigner au primaire et au secondaire. Il faut être pédagogue. Il ne faut pas non plus être mathématicien, littéraire, géographe, biologiste pour enseigner le calcul, la littérature, etc. il faut être pédagogue. Cette décision fut celle de notre ministère de l'Éducation et de notre Université. Pourtant, nous le savons, toutes les commissions nationales d'enquête sur l'éducation, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France ou en Angleterre, ont retenu deux critères fondamentaux du succès de l'enseignement au primaire et au secondaire: l'appartenance et la fierté disciplinaire des instituteurs, l'autonomie et l'initiative des directions d'école. Nous formons en pédagogie des spécialistes de la mesure, de l'évaluation, de la communication, de la "psychologie" de l'enfant et de l'adolescent. Problème : le contenu est évanescent. Faut-il bannir la pédagogie ? Que non! C'est un appoint. Ça ne doit pas, sauf exception, être au coeur de la formation. Je sais qu'il y a un long débat là-dessus, dont nous avons eu des échos dans Le Devoir. Je ne crois pas que la vérité se situe entre les extrêmes qui seraient Jean Larose et certains doyens des Facultés d'éducation du Québec. Je crois, tout simplement, pour ma part, que Jean Larose a totalement raison!
3o Graham Fraser, journaliste, correspondant à Washington puis à Ottawa du Globe and Mail et collaborateur du Devoir n'a pas de formation en journalisme, il a étudié en histoire et il a fait du journalisme étudiant tout au long de ses études. Quand il s'est présenté au premier quotidien qui l'a embauché, il avait deux atouts parmi d'autres: une formation disciplinaire et un cartable rempli d'articles déjà publiés dans des journaux étudiants. Désormais, il semble qu'il faille plutôt passer par le département de communication pour devenir journaliste. En 1996, il y avait en communication le double des inscrits d'histoire. Voilà qui est mieux, n'est-ce pas, cela est plus adapté au marché du travail. Erreur! Qui trouvera à travailler en journalisme ou en communication? Les étudiants et étudiantes qui auront fait du journalisme étudiant et de la radio étudiante, qui sauront écrire et parler, qui sauront penser.
Faut-il abolir le département de communication et de journalisme ? Non, mais ça devrait venir après une formation de base ou encore, ça devrait être une école professionnelle contingentée comme à l'Université Concordia. Pourquoi en est-il ainsi à Laval ? Parce que c'est payant pour les points d'activité et pour le financement de notre Université. En disant cela, je ne remets pas du tout la compétence, d'ailleurs excellente, de mes collègues de journalisme et de communication. Je dis seulement que ce n'est pas sérieux de faire "accroire" à nos jeunes qu'ils deviendront des journalistes s'ils ne passent pas leur temps à écrire et s'ils n'ont pas une formation disciplinaire quelle qu'elle soit.
Le cas de la maîtrise
La même logique de dilution des contenus de formation qui nous conduit
à multiplier les formations à la pièce du premier
cycle devrait nous conduire à diversifier les formes de maîtrise
et à les diluer. Telle qu'elle est, la maîtrise de type B avec
mémoire de 125 pages, constitue un exercice difficile et éprouvant,
c'est un vrai défi à relever. Les étudiants et les
étudiantes qui terminent une maîtrise se démarquent
très nettement de ceux et celles qui terminent un baccalauréat.
La maîtrise suppose un exercice de solitude, un travail de longue
haleine, la mise en oeuvre des habiletés d'analyse et de synthèse.
Le mot "maîtrise" ne nous vient-il pas des corporations
des maîtres et des artisans? C'est la première pièce
d'ensemble, la première création signée par l'artisan.
La maîtrise représente donc un moment de rupture où,
pour la première fois, l'étudiant ne fait plus qu'acquérir
des connaissances et en rendre compte, où il ne fait plus que s'exercer
; cette fois, il produit pour vrai, cette fois il se doit d'être autonome,
responsable et compétent. Son produit - son oeuvre -, son écrit
entre dans le réseau scientifique. Des enquêtes récentes
auprès d'étudiants actuels et anciens nous révèlent
le souhait mainte fois réitéré d'une formation aux
études supérieures qui développe le sens de l'innovation,
l'habileté à gérer le personnel et les tâches,
la capacité de s'autogérer, de maîtriser les langages
de base, la compétence dans les disciplines de son champ d'études.
Ce sont là précisément les compétences que les
étudiants acquièrent en produisant leur mémoire. D'ailleurs,
cela réussit. Le taux de placement des titulaires d'une maîtrise
se situe autour de 90 %.
Pourquoi faudrait-il en réduire les exigences? L'on parle actuellement de créer trois autres maîtrises à scolarité terminale, ne donnant pas accès au doctorat (essai, stage, stage et essai). J'imagine qu'on devrait alors inscrire dans les programmes de ces maîtrises terminales des cours d'auto-gestion des études, de communication en public, d'initiation à la conceptualisation! Cela serait infantilisant et méprisant pour les étudiantes et les étudiants. S'il y a un problème à la maîtrise c'est peut-être qu'elle est trop souvent terminale et qu'il manque de ponts pour passer au doctorat. Un excellent mémoire pourrait constituer un morceau d'une thèse. Par contre la formation de nos docteurs est trop peu exigeante au plan de la scolarité et toute la formation a tendance à se ramener, à se réduire à la problématique de la thèse. Un finissant au doctorat devrait avoir les compétences nécessaires pour donner un cours d'introduction à sa discipline en première année du baccalauréat. Nous en sommes souvent loin. Nous aurions intérêt à nous aligner à cet égard, sur les meilleures universités américaines.
Les voies du décrochage
Je voudrais maintenant aborder un autre point qui semble beaucoup préoccuper
la direction de notre Université, il s'agit du taux de rétention
et du taux de diplômation. À la Faculté des lettres,
le quart des étudiants changeraient de programme et la diplômation
serait du même ordre de grandeur (bacc. en géographie: 21 %
; bacc. en histoire: 23 % ; bacc. en littérature française:
28 %, etc.). Cela implique des coûts en ressources humaines et matérielles
tant pour l'Université et la société que pour les étudiants.
Il y a peut-être à l'Université des départements
et des facultés qui pratiquent la sur-sélection. Tel ne m'apparaît
pas être le cas en Lettres ni non plus en Sciences sociales. Les taux
de rétention et de diplômation sont probablement comparables
à la Faculté des sciences sociales. En sociologie, grosso
modo, un étudiant sur quatre diplôme. Il n'y a pas chez nous
de volonté explicite ou secrète de couler des étudiants.
Nous encadrons beaucoup les étudiants de premier cycle, beaucoup
d'auxiliaires, beaucoup d'écriture, absence d'examens objectifs,
etc. La Faculté offre des cours de rattrapage en français.
Malgré tout cela 75 % ne se rendent pas au bout. Alors pourquoi ?
Parce que nous recrutons beaucoup d'étudiants faibles et moins d'étudiants
forts. Cela est facile à comprendre. Depuis l'école secondaire,
les étudiants forts s'orientent en sciences. À l'Université,
les facultés de sciences et les écoles professionnelles ont
des prérequis. Lettres n'en a pas, les départements (non pas
les écoles) de sciences sociales n'en ont pas non plus, implicitement,
cela envoie le message que ces disciplines ne sont pas sérieuses.
On s'inscrit donc en Lettres ou en Sciences sociales soit parce qu'on est
trop faible, au plan académique, pour s'inscrire ailleurs, soit parce
qu'on en a la passion.
Pourrions-nous faire mieux ? Non. Voici pourquoi. Nous savons qu'il n'y a aucune réussite possible en sciences sociales ou en lettres sans une parfaite maîtrise de l'écriture. Nous le savons et nous le disons, nous faisons même davantage par l'imposition de tests de français. La Faculté des sciences sociales fait mieux, elle offre des cours gratuits et excellents de rattrapage en français. Voilà une mesure réelle et concrète d'appui et d'aide à la formation des étudiants. Notre Faculté ne peut pas faire davantage, la suite appartient aux étudiants. Eux et eux seuls doivent prendre la décision d'assumer leur formation. S'il ne le font pas tant pis pour eux. Le font-ils? Pas tant que cela, il n'y a pas foule aux cours de rattrapage en français et se posent des problèmes de rétention à la fin du trimestre! Quant à moi, j'ai obligé des étudiants à suivre ces cours de rattrapage, au demeurant excellents, j'ai même fait prendre les présences des étudiants concernés, je les ai presque harcelés! On ne peut faire plus. Les étudiants-clients qui croient que les frais de scolarité et le temps passé en classe constituent le prix d'achat de leur formation et qui s'imaginent qu'il n'y aura pas de travail académique à faire sont mieux de quitter. Nous voilà de retour avec la clientèle étudiante. Si les étudiants sont des clients pourquoi travailleraient-ils pour apprendre? Ne suffit-il pas d'acheter? Le 25 % des étudiants qui diplôment au baccalauréat sont ceux qui ont cessé de se voir en clients et qui sont devenus des artisans. Artisans de leur formation, artisans de leur vie.