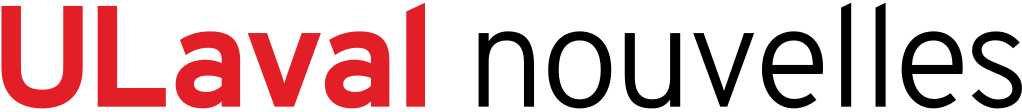|
18 avril 1996  |
FOUS, FOUS, LES CHAPEAUX
Quelqu'un, aujourd'hui, qui se promène le chapeau coquettement
penché sur l'oeil, crânement incliné à l'arrière
ou simplement posé comme couvre-chef, déclenche invariablement
la curiosité des passants. Pour oser porter autre chose qu'un simple
béret ou un banal casque à poils, il faut une certaine dose
d'extravagance.
Exactement la même indépendance d'esprit qu'arboraient les
gens dans les années cinquante lorsqu'ils se promenaient tête-nue
en ville. À cette époque, entrer à l'église
sans chapeau, aller au cinéma ou à une réception sans
être «couvertes» constituait pour les femmes une faute de
goût qui rejaillissait sur l'ensemble de leur tenue vestimentaire.
Mireille Racine, étudiante en maîtrise d'ethnologie sous la
direction de Joceylyne Mathieu, s'intéresse justement à cette
époque charnière pour l'industrie de la chapellerie, en tentant
de comprendre pourquoi les couvre-chefs ont brusquement disparu de notre
habillement.
L'exposition qu'elle présente à la Bibliothèque Gabrielle-Roy
de Québec jusqu'au 21 avril retrace à grands traits l'histoire
du chapeau à Québec depuis la Seconde Guerre mondiale. Essentiellement
féminine, cette activité se concentrait dans des ateliers
autour de la rue Saint-Joseph, dans le quartier Saint-Roch, non loin des
fournisseurs de feutre, de velours, de crin ou de paille et des grands magasins
comme Paquet, Le Syndicat ou Laliberté. «Pâques représentait
une date charnière pour la mode du chapeau, explique Mireille Racine
qui a conçu l'exposition. Même si le temps ne s'y prêtait
guère, les femmes étrennaient leur chapeau de l'année,
un symbole du changement de saison.»
Élégantes, jusqu'au bout du chapeau
Chapelière elle-même, l'étudiante raconte que les modistes
s'efforcaient souvent de rafraîchir un couvre-chef en lui ajoutant
une voilette, des fleurs, des plumes. Une même base de chapeau pouvait
ainsi servir plusieurs années successives et s'harmoniser à
la couleur de la toilette. Du bibi, aux souliers, en passant par le sac,
les gants, la pochette de tissu, les femmes ne négligeaient aucun
détail avant de sortir. Qu'il s'agisse de l'imitation d'un oiseau
douilletement blotti au creux d'un nid de velours, d'une toque rapppelant
un champ de fraises sauvages, ou de capelines de paille presque volantes,
les chapeaux exposés témoignent d'ailleurs du goût des
élégantes pour la fantaisie. Une extravagance qui colle mal
avec l'image terne et noire véhiculée aujourd'hui sur une
époque souvent qualifiée de très conventionnelle.
Pourtant, cette composante de l'habillement, objet de tant de soins et d'attention,
n'a pas survécu longtemps à la tornade des années soixante.
«Avec le développement des coiffeurs et des permanentes, les
femmes voulaient montrer leurs cheveux, explique Mireille Racine. Les jeunes
n'acceptaient plus de copier les toilettes de leurs mères. Les filles
ont commencé à porter des jeans, de grandes jupes bariolées
en abandonnant les gants et le chapeau, symboles de la bourgeoisie et la
tradition.»
À l'inverse, en regardant les créations de cette chapelière
résolument moderne, exposées dans une salle contigüe,
on a l'impression que le port du chapeau dans les années 90 s'apparente
presque à une prise de position artistique. En mariant des matériaux
inusités comme des pièces de bicyclette, de téléphone,
un fermoir, une passoire, avec du velours, des rubans ou du feutre, Mireille
Racine fabrique des chapeaux qui se rapprochent étrangement de sculptures
ou de pièces d'art. Bien loin en quelque sorte du béret en
laine qui a survécu à la décadence du couvre-chef.