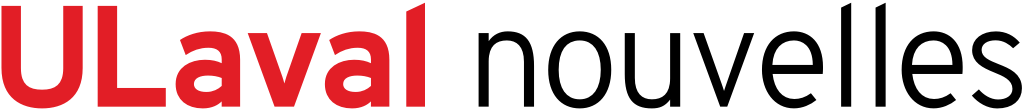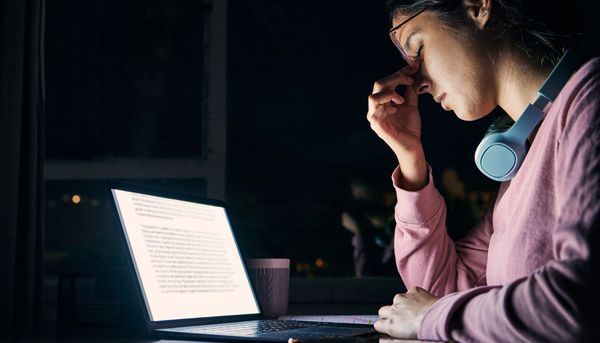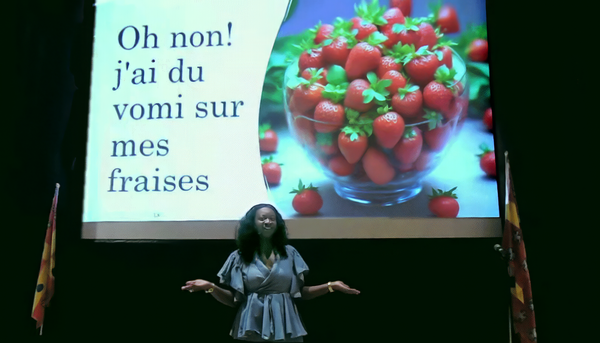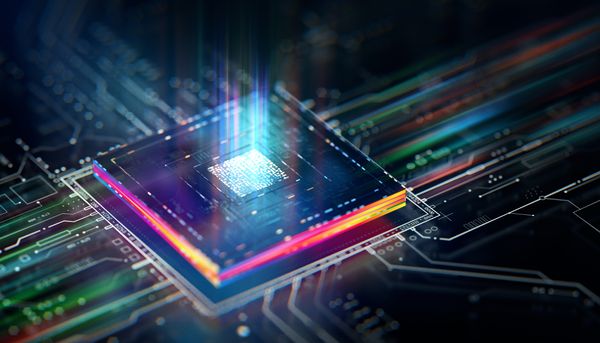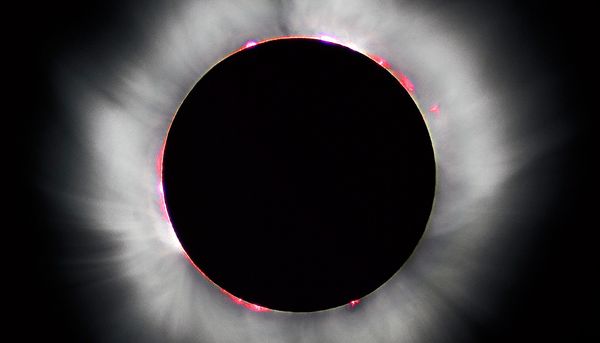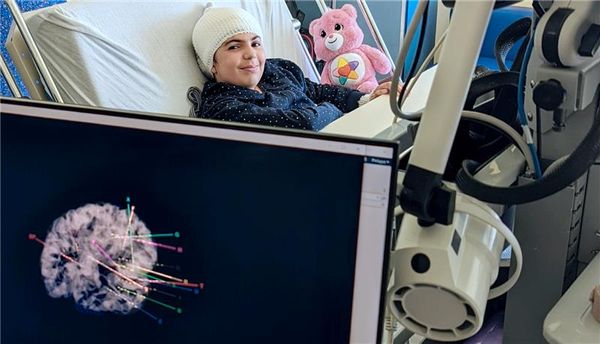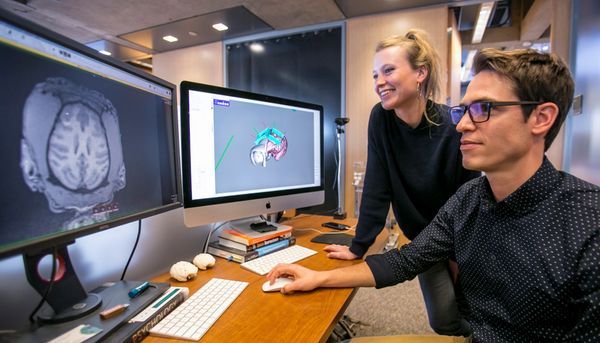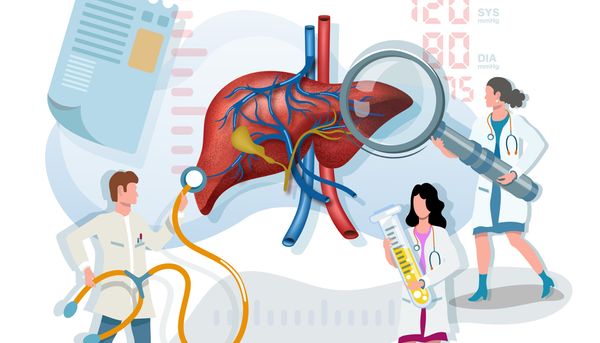Scène de nuit au Nunavik, au bord d’un lac du parc national Tursujuq. Une tente inuite en canevas apparaît sous la splendeur d’une aurore boréale dans le ciel polaire.
— Steve Deschênes
Le vendredi 9 décembre, pas moins de 22 étudiantes et étudiants inscrits en majorité à la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional, ont présenté les enjeux et les perspectives de 6 aires protégées disséminées dans quatre régions du Québec ainsi qu’aux États-Unis et en France. Ce sont, au Québec, le parc national Tursujuq, la réserve de biodiversité Uapishka, la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente et le parc de la rivière des Mille-Îles. Aux États-Unis se trouve le parc des Catskill et, en France, le parc national de Port-Cros. Ce colloque a eu lieu au pavillon Charles-De Koninck et était retransmis par visioconférence. L’activité était organisée dans le cadre du cours Parcs et réserves naturels: enjeux et perspectives.
Au Nunavik, dans le Grand Nord québécois, au carrefour culturel des Inuits et des Cris, le parc national Tursujuq, créé en 2013, couvre une superficie de plus de 26 000 kilomètres carrés, ce qui fait de lui la plus grande aire protégée au Québec. De forme rectangulaire, il touche à la baie d’Hudson sur son versant ouest. On y trouve notamment le lac Wiyâshâkimî, le deuxième plus grand lac naturel au Québec. Les phoques communs d'eau douce de l’endroit sont l’une des seules populations au monde de cette espèce. Cette sous-zone de la toundra forestière marque la transition entre la zone boréale et la zone arctique. Son climat est subarctique.
«Avec le statut d’aire protégée du parc, la biodiversité bénéficie d’une grande connectivité entre les différents écosystèmes et surtout d’une protection contre l’exploitation des ressources naturelles», explique Océane Robert. Avec Anthony Asselin (biologie), Pauline Marchiano (aménagement du territoire et développement régional) et Dominique Moncion-Groulx (biogéosciences de l’environnement), cette étudiante visiteuse au deuxième cycle a présenté les résultats du travail d’équipe sur le parc. «Il n’y aura jamais de mines, de barrages hydroélectriques ou de coupes forestières à l’intérieur des limites du parc, poursuit-elle. Ces limites pourraient être agrandies dans le futur.»
Les bélugas de la baie d’Hudson côté est sont au cœur d’un problème de surpêche de la part des populations autochtones. Celles-ci détiennent un droit exclusif de pêche et de chasse sur ce territoire protégé. «La surpêche est importante, indique l’étudiante. De plus, l’habitat estuarien se dégrade. Les autorités du parc mènent des campagnes de sensibilisation.»
Les problèmes qui affectent la biodiversité du parc sont aussi d’origine climatique. Selon l’étudiante, avec le dérèglement du climat, de nombreuses espèces du sud migrent au nord. «Par exemple, dit-elle, la population d’orignaux a beaucoup augmenté ces dernières années dans le parc. Des castors, des moineaux, des rouges-gorges, des oies des neiges et des écureuils ont été aperçus. La migration de ces espèces, qui sont habituées aux climats continentaux, démontre qu’il y a eu un réchauffement des températures ambiantes.»
Le tourisme, une priorité pour le développement économique
Le Nunavik compte actuellement quatre parcs nationaux et deux autres sont à l’état de projets. En 2019, environ 600 personnes ont visité ces aires protégées. Plus de la moitié étaient des touristes. Les jeunes, membres de groupes scolaires, étaient un peu moins de 200. Le parc national Tursujuq comprend une demi-douzaine de camps de type bungalow en bois. Ces camps servent à l’hébergement des touristes. Ils sont également utilisés pour les activités des communautés locales et des bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
Il n’existe pas de route en béton dans ce parc. Les déplacements se font en canot à moteur, en véhicule tout-terrain et en motoneige.
Les activités à faire vont de la randonnée pédestre à l’observation de la faune et de la flore, en passant par le kayak de mer, le ski de fond et le vélo à pneus surdimensionnés (fat bike). Les activités traditionnelles auxquelles s’adonnent les populations autochtones comprennent la pêche et la chasse, la cueillette de fruits, le fumage de poisson et les chiens de traîneaux, de même que le chant de gorge.
Les Inuits et les Cris sont impliqués dans l’aménagement et la gestion des parcs du Nunavik. Le budget annuel de la société Parcs Nunavik s’élève à 9 millions de dollars et se répartit entre les quatre parcs nationaux du territoire. Le personnel comprend une trentaine d’employés.
«Les Inuits occupent plusieurs postes dans les parcs du Nunavik comme guides pour les touristes, gardes de parc et personnel administratif, souligne Océane Robert. Grâce à la transmission de génération en génération des savoirs traditionnels, leur grande connaissance du territoire et de l’environnement spécifique à chaque parc font d’eux d’excellents guides et gardes de parc. Nous savons, par exemple, que les Inuits ont été sollicités, notamment pour leur connaissance du terrain, dans le cadre du projet du parc national d’Ulittaniujalik.»
La présentation sur le parc national Tursujuq a pris fin sur une demi-douzaine de recommandations. Les étudiantes et les étudiants recommandent, entre autres, d’actualiser le plan directeur du parc, de renforcer les mesures d’adaptation pour faire face au réchauffement climatique et de décentraliser l’administration et les spécialistes en conservation du bureau de Parcs Nunavik, situé à Kuujjuaq, afin qu’ils puissent être présents plus régulièrement sur le terrain. Ils recommandent également de continuer à acquérir des connaissances sur la grande variété d’écosystèmes et sur la biodiversité du parc.
«Étant donné l’immensité du territoire, explique l’étudiante, les espèces floristiques et faunistiques présentes ne sont pas toutes connues. Nous préconisons d’effectuer des recherches à cet égard. De plus, dans un contexte de changements climatiques, il est important de savoir comment ces phénomènes se manifestent sur le territoire ainsi que de trouver des solutions basées sur des données probantes pour améliorer la résilience du parc et des espèces.»
Le colloque étudiant n’était pas la seule activité sur les aires protégées à avoir eu lieu en marge de la COP 15 sur la biodiversité, laquelle se déroule à Montréal du 7 au 19 décembre. Rappelons que le 6 décembre, une midi-causerie en ligne de l’Institut EDS de l’Université Laval a eu lieu sur le thème «Les aires protégées à objectifs multisectoriels, une option pour les enjeux de conservation actuels». Le présentateur était le chercheur postdoctoral Denis Blouin, chargé de cours au Département de géographie.

Le kayak de mer est l’une des activités offertes au parc national Tursujuq, tout comme l’observation de la faune et de la flore, le ski de fond et le vélo à pneus surdimensionnés (fat bike).
— Nunavik Parks

Carte du parc national Tursujuq avec, à droite, sa localisation au Nunavik. Le parc couvre une superficie de plus de 26 000 kilomètres carrés.
— MFPP