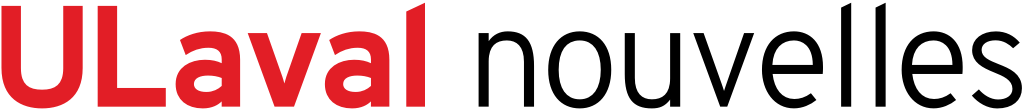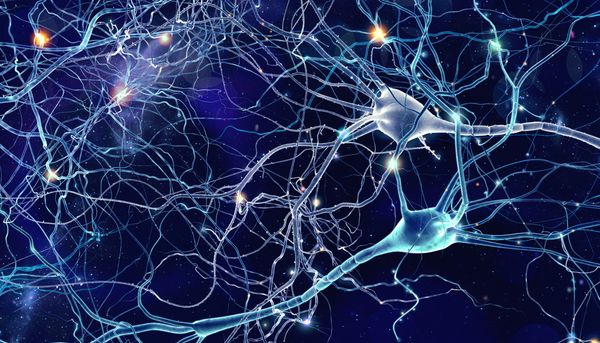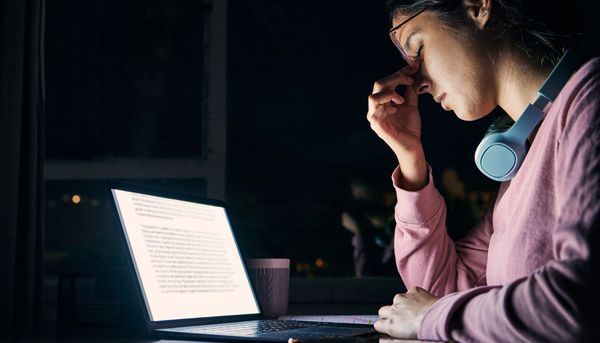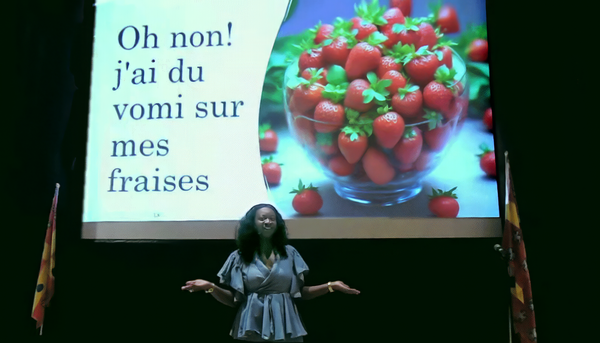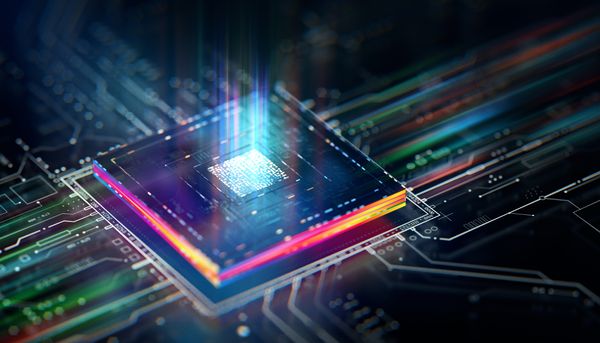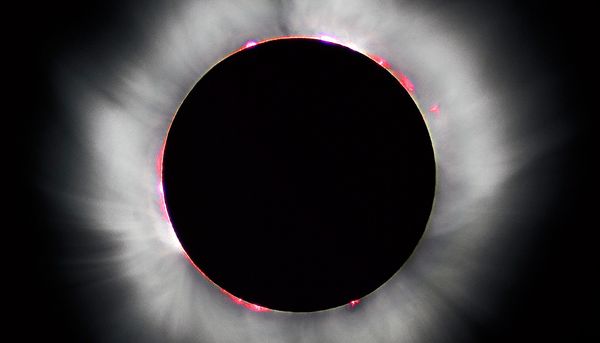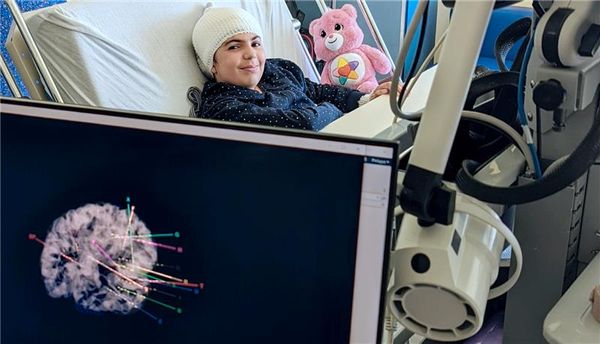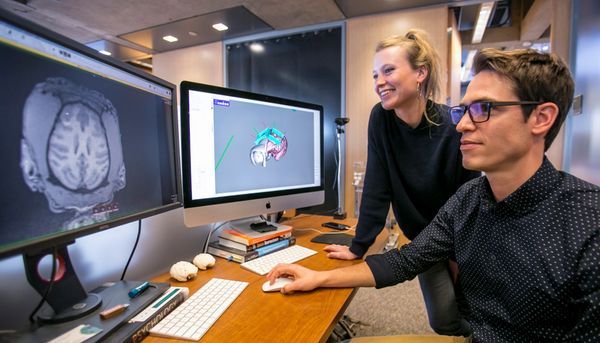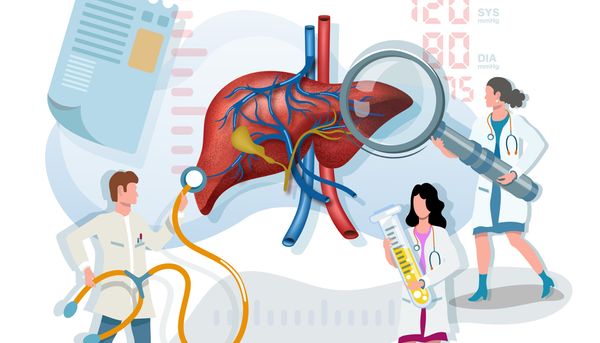À peu près la moitié des suspects, soit 45%, avouent leurs crimes lors d'un interrogatoire de police, d'après les études récentes. L'attitude des policiers joue un rôle important.
— GETTY IMAGES/Evgeniy Shkolenko
Nostalgiques de District 31, voici un sujet d'étude qui devrait vous intéresser. La professeure de criminologie Nadine Deslauriers-Varin se promet d'ailleurs d'écouter un jour la célèbre télésérie, elle qui concentre ses recherches sur les interrogatoires policiers. Qu'est-ce qui fait qu'un suspect collabore ou non? L'âge, l'état matrimonial et le statut parental ont moins d'influence. En contrepartie, l'attitude des policiers, la perception de l'importance de la preuve et le recours à un avocat pèsent plus lourd dans la balance. Ce que l'on découvre, c'est que ces facteurs interagissent et que leur combinaison peut changer la décision de passer aux aveux.
À peu près la moitié des suspects, soit 45%, avouent leurs crimes lors d'un interrogatoire de police, d'après les études récentes. Les chercheurs tentent de comprendre leurs motivations. Un aspect novateur des travaux de la professeure Deslauriers-Varin est qu'ils reposent sur ce que l'on appelle des données «autorévélées». Elle a sondé les perceptions de 221 détenus incarcérés dans un pénitencier canadien à sécurité maximale de Sainte-Anne-des-Plaines.
«Je les ai tous rencontrés par groupe d'à peu près une vingtaine, dit-elle. J'avais des questionnaires s'ils avaient collaboré, s'ils n'avaient pas collaboré, j'avais des questionnaires plus généraux sur leur bagage, sur leurs antécédents. C'était très riche d'aller chercher leur opinion, leur vision de ce qui s'était passé, la façon dont ils ont vécu l'interrogatoire, de pouvoir leur demander à quel point tel facteur avait été décisif dans leur décision de se confesser ou pas.»

Pour cette étude, la professeure en criminologie à l'Université Laval a sondé les perceptions de 221 détenus incarcérés dans un pénitencier canadien à sécurité maximale de Sainte-Anne-des-Plaines.
— Nadine Deslauriers-Varin
Ce genre de données est plutôt rare, souligne la professeure. Généralement, les chercheurs font des études expérimentales, en mettant des étudiants en contexte de simulation de délit et d'interrogatoire, une pratique répandue en Europe. Sinon, ils travaillent à partir d'interrogatoires filmés ou audio, ce qu'il n'y a pas en grande quantité.
Nadine Deslauriers-Varin a, quant à elle, pu compter sur un échantillon «très représentatif», alors que le taux de participation des détenus s'élevait à près de 80%.
Arbres décisionnels
Son étude s'est aussi démarquée par son approche. La plupart des recherches se sont penchées sur l'influence individuelle des facteurs qui expliquent la confession. «Souvent, on va voir les choses comme un bloc statique, comme une ligne», indique la professeure Deslauriers-Varin. Il a été démontré que de faire appel à un avocat diminue les chances de confession; alors, à partir du moment où un avocat est engagé, on se dit que c'est terminé, qu'on n'aura pas de collaboration.
«Mais ce n'est pas juste une ligne, il y a plusieurs lignes possibles», poursuit la chercheuse qui analyse des «arbres décisionnels» pour déterminer les associations, la hiérarchie et le poids relatif de chacun des facteurs explicatifs. «À chaque branche, il y a un niveau de probabilité que la personne collabore ou pas. Il y a des ramifications. C'est un processus itératif, qui se développe dans le temps.»
Donc, même si un suspect prend un avocat, si l'attitude des policiers en interrogatoire est empathique et respectueuse plutôt qu'intimidante, si la preuve est solide et efficace, on réaugmente les chances de collaboration. Cette interaction entre les facteurs et leur influence combinée n'avaient pas encore été démontrées.
Des pistes pour les policiers
Sans faire de recommandations détaillées pour les techniques d'interrogatoire, l'étude donne de bonnes pistes, indique Nadine Deslauriers-Varin. Notamment sur l'importance du rôle de l'enquêteur. «S'il est à l'écoute, s'il crée un lien qui fait un peu tomber les barrières, il sera ensuite capable de travailler avec le suspect, puis d'aller chercher, peut-être pas une confession, mais à tout le moins les informations pertinentes qui vont faire avancer l'enquête, qui vont venir corroborer certains éléments de preuve.»
Depuis quelques années déjà, ces principes de bonne pratique sont mis de l'avant, même à l'école de police, souligne la professeure. Le Québec et le Canada sont plutôt avant-gardistes, dit-elle. «Le cadre légal aux États-Unis permet de créer de la preuve, donc de mentir au suspect qu'on rencontre en disant qu'on a tel élément de preuve. Ici, ce serait inadmissible à la cour si des aveux étaient obtenus à la suite de ce genre de manipulation.»
— Nadine Deslauriers-Varin, en parlant des interrogatoires policiers
Elle ajoute qu'«il y a une façon de faire au Québec qui est très basée sur la science». Les milieux policiers sollicitent de plus en plus les chercheurs pour améliorer leur pratique. Ce qui réjouit la professeure, dont les projets sont quasiment tous faits en partenariat avec eux.
Prix Publication en français
Diffuser ses résultats en français et en libre accès au grand public lui tient particulièrement à cœur, pour que ses travaux puissent avoir des retombées pratiques. C'est ce qu'elle a pu faire en publiant son étude dans la revue scientifique Criminologie, un numéro spécial dont elle était l'éditrice invitée.
Pour ce projet, la professeure Deslauriers-Varin a d'ailleurs reçu le prix Publication en français Louise-Dandurand des Fonds de recherche du Québec, décerné en mars par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. «C'est une super belle initiative provinciale, lance celle qui a toujours écrit en anglais. C'est un milieu très anglophone, particulièrement dans le domaine de l'enquête policière. Les chercheurs au Canada qui travaillent dans l'interrogatoire, il n'y en a pratiquement pas. Ça se passe beaucoup aux États-Unis et majoritairement en Angleterre.»
Elle se dit très touchée par cette reconnaissance.
Si elle n'a pas vu l'œuvre de Luc Dionne, District 31, Nadine Deslauriers-Varin s'amuse à constater l'évolution des techniques d'interrogatoire à travers d'autres séries. Selon l'époque ou l'âge que l'on a, les références changent, de la menace du bottin de téléphone à la technique «bon cop, bad cop». Sa recommandation pour l'été? «Ça s'appelle Criminal. Comme dans toutes les séries, il faut en prendre et en laisser, mais celle-là est l'une des rares où je voyais les modèles d'interrogatoire plus actuels. Comme elle a été reprise par différents pays, France, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni, elle a un aspect comparatif intéressant.»
En savoir plus sur l'étude de Nadine Deslauriers-Varin, Facteurs explicatifs de la confession en contexte d'interrogatoire policier: une analyse d'arbres décisionnels.