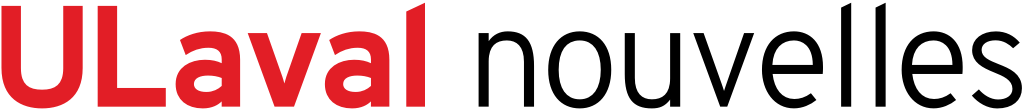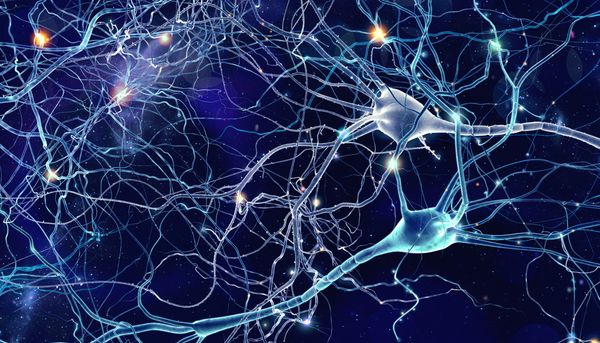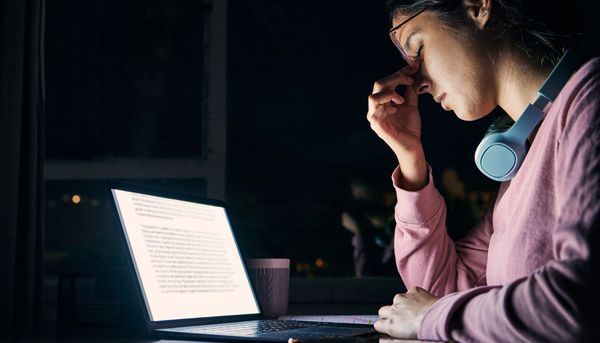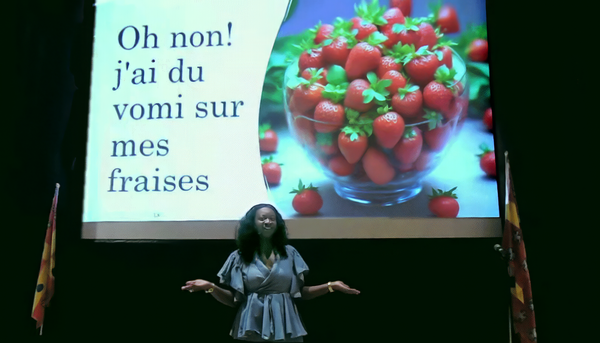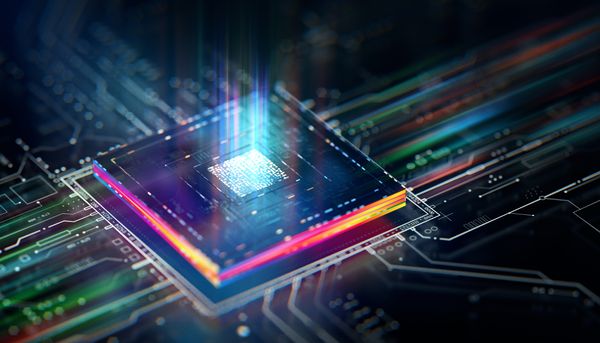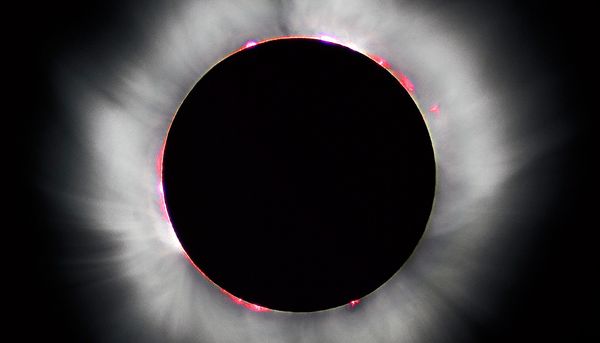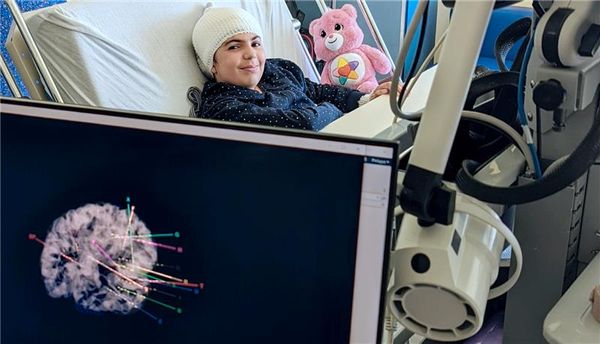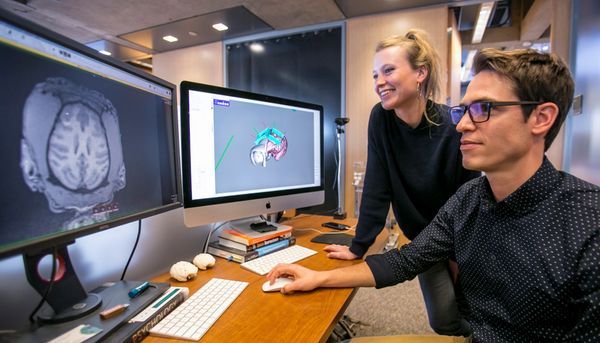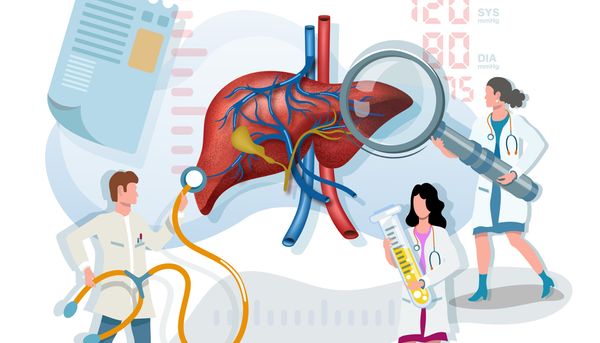Le Penseur est l’une des plus célèbres sculptures en bronze d’Auguste Rodin. Elle représente un homme en train de méditer.
— CrisNYCa
Le jeudi 30 septembre, la Faculté de philosophie a souligné de façon originale la rentrée universitaire. Une activité sociale, la première depuis de nombreux mois au pavillon Félix-Antoine-Savard, a réuni une cinquantaine de personnes, étudiants comme professeurs. Tous ont assisté à la présentation de 15 livres publiés par les enseignants de la Faculté entre 2019 et 2021. L’activité a vu le jour à l’initiative du professeur Bernard Collette.
«Je ne me rappelle pas qu’autant de livres aient pu s’écrire en si peu de temps, c’est un nombre tout à fait impressionnant, souligne le doyen Luc Langlois. Cela donne une idée du travail de recherche fait pendant la pandémie. La vie ne s’est pas arrêtée. Ce qui me frappe en particulier est la variété des thèmes. Ils reflètent la recherche qui se fait à la Faculté.»
En quelques chiffres, la Faculté de philosophie compte une vingtaine de professeurs et une vingtaine de chargés de cours. Elle offre une dizaine de programmes d’enseignement comptant environ 500 étudiants au total. Quelque 2000 autres, disséminés sur le campus, sont inscrits à différents cours à option ou à un certificat à distance. Les activités de recherche, quant à elles, sont regroupées dans trois grands secteurs. Il y a d’abord la philosophie ancienne et médiévale, ensuite la philosophie moderne et contemporaine de Descartes à aujourd’hui, enfin la philosophie pratique comprenant la politique, la morale et l’éthique appliquée.
Selon le doyen, l’entreprise de longue haleine que constitue l’écriture d’un livre ne se fait pas au détriment de la production d’articles scientifiques pour les revues savantes. «L’un n’exclut pas l’autre, dit-il. Les professeurs continuent à publier des articles tout en écrivant un livre. Les articles demeurent une activité très importante. L’outil livre, lui, représente un référent très important en philosophie. Il demeure un outil central de référence, il reste.»
Vrin, Hermann, Les Belles Lettres, Classiques Garnier, Routledge: une forte majorité des ouvrages présentés le 30 septembre ont été édités en Europe.
«Ces éditeurs sont des maisons où ne publie pas qui veut, explique Luc Langlois. Que nos professeurs aient publié à ces endroits marque pour eux une forme de reconnaissance internationale.»
Quelques-uns des ouvrages présentés le 30 septembre
L’ouvrage collectif Heidegger aujourd’hui. Actualité et postérité de sa pensée de l’événement, codirigé par Sophie-Jan Arrien, de l’Université Laval, et Christian Sommer, publié en 2021 chez Hermann à Paris, tente de reconnaître «ce qui est mort» et «ce qui est encore vivant» dans le legs de ce penseur allemand aussi important que controversé. Les contributions, centrées sur la pensée heideggérienne des années 1930 autour des thèmes de l’histoire, de la technique, de la poésie, de la science, du mythe, du politique et du divin, en interrogent tant les réelles percées que les impasses.
L’ouvrage de Vincent Boyer, Promesse tenue. Agir par devoir, publié en 2021 chez Classiques Garnier, à Paris, explore le thème classique en philosophie morale du motif du devoir, en prenant comme fil directeur le cas de la promesse tenue. Est-il possible d’agir uniquement par devoir d’une part, et, si c’est possible, est-ce le motif du devoir qui fait d’une action une action spécifiquement morale? Il s’agit du «problème du catégorique d’un point de vue motivationnel» car, pour agir, il semble qu’il faille trouver des raisons au devoir extérieures au devoir. Par exemple, que l’on considère, à tort ou à raison, qu’il est bon, dans cette circonstance, de faire son devoir; car autrement notre action serait irrationnelle.
The Stoic Doctrine of Providence. A Study of its Development and of some of its Major Issues paraîtra à New York et Londres en 2022 chez Routledge. Ce livre de Bernard Collette, le premier en son genre, examine la doctrine stoïcienne de la providence, depuis les fondateurs grecs de la Stoa (Zénon de Cition, Cléanthe d’Assos et Chrysippe de Soles) jusqu’aux stoïciens romains (Sénèque, Épictète et Marc Aurèle). Il montre comment la notion de providence divine a amené les stoïciens à développer l’idée de «philanthropie», c’est-à-dire d’amour pour le genre humain, qui détermine leur éthique (autrui n’est jamais un étranger) et leur politique (chaque homme doit se montrer utile aux autres hommes).
Angela Ferraro a publié La Réception de la philosophie de Malebranche en France au XVIIIe siècle. Métaphysique et épistémologie chez Classiques Garnier, à Paris, en 2019. L’ouvrage adopte un point de vue particulier sur un phénomène courant en histoire de la philosophie: celui de la réception d’un système de pensée. On montre comment, au 18e siècle, les idées de Nicolas Malebranche (1638-1715) ont pu faire l’objet de lectures différentes issues des mécanismes complexes de découpage et de recontextualisation. L’ouvrage souhaite en outre contribuer à l’avancement du débat historiographique, en justifiant davantage le statut de Malebranche comme grand philosophe de l’époque moderne et en mettant en valeur le caractère proprement philosophique de la réflexion développée par les auteurs des Lumières.
Le sentiment de l’existence. Lectures des Rêveries du promeneur solitaire de Rousseau a été publié chez Hermann, à Paris, en 2021. Ce volume collectif codirigé par Philip Knee et réalisé en collaboration avec Thierry Belleguic, de l’Université Laval, réunit quinze études sur les Rêveries du promeneur solitaire, la dernière œuvre de Rousseau, interrompue par sa mort en 1778. Écrites par des chercheurs d’Amérique du Nord et d’Europe, à la fois philosophes et littéraires, les contributions explorent le regard rétrospectif que Rousseau jette sur sa vie en revisitant certains des thèmes les plus célèbres de sa pensée, comme la connaissance de soi, le sentiment de la nature et la solitude.
Dans le domaine de la philosophie médiévale, Claude Lafleur a présenté deux dossiers thématiques et deux livres. Le dossier thématique paru en 2020 dans la revue Phares, sous la codirection de Joanne Carrier, de l’Université Laval, et avec la collaboration de Violeta Cervera Novo, de la même université, s’intitule Interpréter Aristote, De l’interprétation. Il porte sur un traité de logique d’Aristote célèbre pour la consonance sémiotique et linguistique de ses premiers chapitres et pour la doctrine des futurs contingents. En 2019, Claude Lafleur, avec la collaboration de Joanne Carrier, a fait paraître La «Vieille logique»des Communia version parisienne du Pseudo-Robert Grosseteste, chez Vrin, à Paris, et à Québec, aux Presses de l’Université Laval. Ce livre offre la première édition critique – avec introduction, traduction française et annotations – d’un document latin jusqu’alors inédit du 13e siècle qui renseigne sur les débuts de l’enseignement universitaire de la logique.
La Métaphysique de Baumgarten fut le plus important traité de métaphysique en Allemagne durant la seconde moitié du 18e siècle. Plusieurs milliers d’étudiants, dont plusieurs sont devenus des penseurs de renom, ont été formés à travers cet ouvrage, qui constitue en quelque sorte un concentré des principales thèses métaphysiques de Wolff et de Leibniz. Le traité fut utilisé par Kant durant plus de quarante ans pour son propre enseignement. Il a même inspiré le plan de rédaction de sa célèbre Critique de la raison pure. Luc Langlois en offre ici la première traduction française, réalisée en collaboration avec Émilie-Jade Poliquin, en plus d’un commentaire et d’une introduction substantielle.
Dans le cadre des travaux de sa chaire (Antiquité critique et modernité émergente) touchant la façon dont la civilisation grecque, d’esprit exceptionnellement critique, a marqué la pensée occidentale et pas seulement, Jean-Marc Narbonne a fait paraître simultanément trois ouvrages. Tout d’abord, une étude montrant l’importance pour Aristote de la sagesse collective et de la démocratie modérée, une constitution appelée «politie», à savoir un régime démocratique assorti d’éléments oligarchiques: Sagesse cumulative et idéal démocratique chez Aristote (Québec/Paris, Pul/Vrin, 2021); ensuite, un essai original, voire «révolutionnaire», sur le message démocratique méconnu de la tragédie Antigone de Sophocle, une pièce exhibant les pièges d’une gouvernance autocrate comme celle pratiquée par Créon: Démocratie dans l’Antigone de Sophocle. Une relecture philosophique (Québec/Paris, Pul/Vrin, 2021); puis, en collaboration avec Lorenzo Ferroni (Université de Florence), une édition savante, avec commentaires et notes, de quatre traités de Plotin: Plotin. Traités 30-33, Paris, Les Belles Lettres [Collections des Universités de France] 2021.
Marie-Hélène Parizeau a fait paraître aux PUL, en 2021, De la médecine technicienne à la santé écologique. Repenser la bioéthique, un ouvrage écrit avec la collaboration de Josée Anne Gagnon, de l’Université Laval. Ce livre de bioéthique propose aux soignants, aux étudiants et aux spécialistes des sciences humaines, des pistes de réflexion et de solutions pour analyser la conjoncture technicienne qui transforme la pratique médicale et la relation patient-soignant. Un nouveau modèle semble émerger avec «un médecin technicien déroulant les algorithmes décisionnels auquel répond «un patient expert» de sa maladie, informé par Internet, rationnel et autonome. En mettant l’accent sur la centralité de la relation, de l’expérience clinique, et du care, en puisant à différentes sources philosophiques et en utilisant des récits cliniques, ce livre amène progressivement le lecteur vers une autre conception de la santé, celle de la santé écologique, à partir d’autres valeurs telles que l’interdépendance entre les êtres humains et leur environnement, la vulnérabilité, le «prendre soin» ou la justice environnementale.
Voir la liste complète des livres présentés le 30 septembre (PDF)